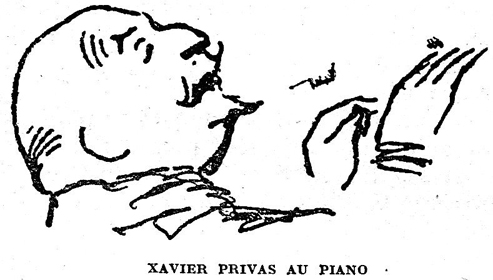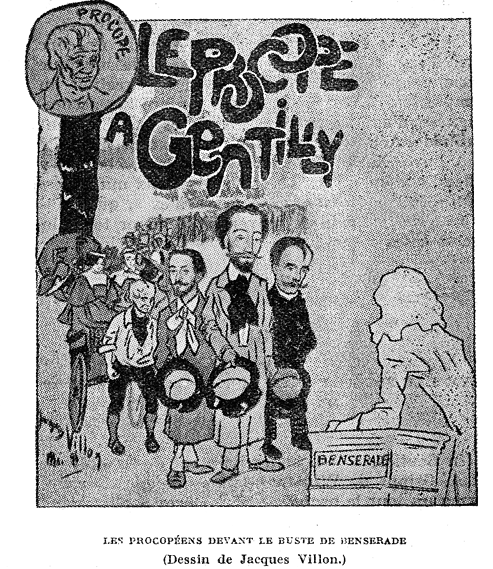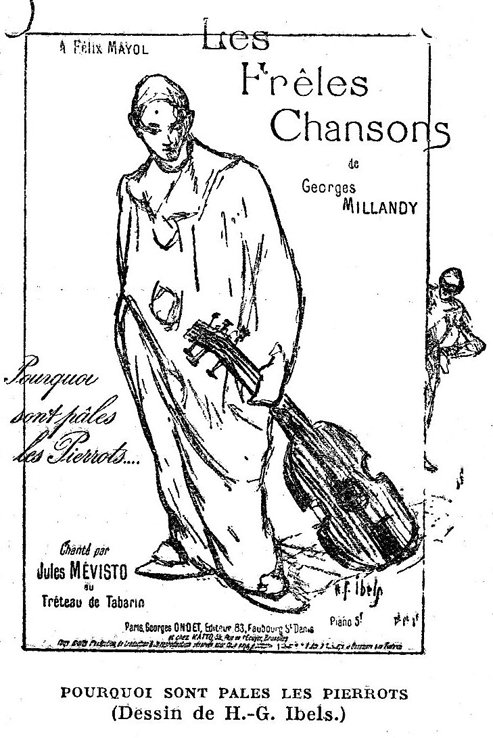Lorsque tout est Fini...
Georges Millandy
Souvenirs d'un chansonnier du Quartier Latin.
PARIS
ALBERT MESSEIN, EDITEUR
19, Quai Saint-Michel, 19 1933
Préface de GUSTAVE FRÉJAVILLE
TABLE DES MATIERES
___________
. |
Lorsque tout est fini...
MÉMOIRES D'UN DU BOUL' MICHE
I.
Le caveau du "Soleil d'Or". - Histoire d'un pseudonyme. - à la table de Paul Verlaine. - La cigarette. - La boulangerie Bovy.
J'arrivai à Paris par un de ces beaux soirs d'octobre où après l'accalmie des vacances la vie semble reprendre plus intense dans la grande ville.
Le vieux fiacre qui me conduisait descendit la rue de Rennes, s'engagea dans la ruelle étroite de l'école de Médecine et déboucha sur le boulevard Saint-Michel ruisselant de lumière. Des bandes de jeunes gens coiffés qui de bérets, qui de chapeaux hauts de forme, déambulaient en chantant?:
Les p'tit's femmes du Quartier
Sont les femm's les plus chouettes ;
Pour aller vadrouiller,
Elles sont toujours prêtes.
Ell's savent égayer
Notre vie de bohème'
C'est pour ?a qu'on les aime,
Les p'tit's femm's du Quartier !
Les terrasses du Vachette, du Soufflot, du Balzar étaient garnies de consommateurs. Des cris joyeux montaient dans la fumée légère des cigarettes et des rires de femmes fusaient autour des guéridons encombrés de soucoupes.
Un ami m'avait indiqué un petit hôtel, rue des écoles, où je devais trouver pour trente-cinq francs par mois, une chambre avec balcon et cabinet noir: un somptueux appartement.
Après avoir déposé mes bagages et remplacé ma casquette de voyage par un feutre magnifique, j'arpentais le boulevard Saint-Michel, la cigarette aux lèvres, quand je croisai un vieux camarade de collège... Un demi s'imposait. Nous nous assîmes à la terrasse du café Soufflet. Après avoir longuement parlé du passé, nous nous confi?mes nos projets. Mon ami me déclara qu'il voulait "faire de la littérature" et qu'il venait d' "entrer dans un journal". Je lui appris que je composais de petites chansons, en attendant de pouvoir écrire de grands poèmes.
Tu fais des chansons ? s'écria mon confrère, bravo ! Je vais pouvoir t'être utile et, dès ce soir, je veux t'emmener dans un caveau où tu feras la connaissance de types épatants. C'est là, tout près, sur la place Saint-Michel, au Soleil d'Or.
"Je suis très bien avec le patron, ajouta-t-il d'un petit ton suffisant. Tu comprends : un journaliste !"
Nous descendîmes le Boul'Miche, bras dessus, bras dessous.

Le Caveau du Soleil d'Or était aménagé -si j'ose dire ainsi- dans les caves d'un quelconque café, au coin de la place Saint-Michel et du quai du même nom. Nous nous engage?mes dans un étroit escalier et pénétr?mes dans une grande salle aux murs jaunis par le tabac et éclairée par des papillons de gaz qui, péniblement, laissaient tomber, au milieu de la fumée des pipes, cette "obscure clarté" chère aux poètes de tous les temps.
Comme la décoration, l'ameublement était des plus simples : tabourets vulgaires et tables banales, encombrées de bocks - que l'on payait trente centimes ! Heureux temps !...
Sur une petite estrade, un piano fatigué montrait ses dents ébréchées et noircies par les cigarettes.
Au bout de quelques instants, je commen?ai d'apercevoir dans le fond de la salle, sur le mur, une peinture représentant un coucher de soleil derrière Notre-Dame.
L'&œlig;uvre ne manquait pas d'originalité : onques on n'avait pu voir, en effet, pareil embrasement du ciel derrière la basilique, le soleil s'obstinant déjà, à cette époque, à se coucher de l'autre côté !
Mon ami le journaliste me désigna quelques personnalités : Jean Carrère qui menait alors grand tapage au Quartier Latin, le poète Maurice Boukay, l'auteur, avec Paul Delmet, des Stances à Manon, Laurent Tailhade, hautain et ironique ; Alcanter de Brham, superbe et monoclé ; les dessinateurs R&œlig;del et Mucha ; l'imagier André des Gachons ; le sculpteur Niederhausen ; le jeune peintre Chaumont qui, sous son feutre haut de forme, ressemblait à Ange Pitou ; d'autres encore : Neuburger, Paul Brulat, le comédien Bressol, le clown Karyon, la basse Bonnet, qui chantait le dimanche au lutrin et que ses camarades avaient surnommé le "chantre mou", et une douzaine de chansonniers du Quartier Latin qui formaient la troupe bénévole du Soleil d'Or.
Gravement annoncés par le maître de céans, un ancien employé du bureau de la Compagnie de l'Est nommé Méryc, qui faisait fonctions de directeur artistique, auteurs et interprètes se succédaient sur le tremplin. Après chaque poème, éclataient des applaudissements sonores que ponctuait un ban vigoureux.
Le programme était laissé au hasard ; mais le hasard, ce soir-là, fit bien les choses. J'eus, en effet, la bonne fortune d'applaudir , Gaston Dumestre, un jeune chansonnier de grand talent qui n'a pas aujourd'hui, la place qu'il mérite ; Yan Nibor, le poète de la mer, l'auteur de ce: petit chef-d'&œlig;uvre, La Boîte de Chine ; le compositeur Le Bayon, qui disait avec infiniment de charme La Fille du Roi ; Eugène Lemercier dont le répertoire un peu égrillard mit la salle en joie ; F: A. Cazals, le chansonnier-dessinateur, semblable, avec sa redingote à taille et sa canne d'Incroyable, à un conspirateur de La Fille de Madame Angot ; Joseph Canqueteau, qui s'était fait une manière de célébrité avec sa chanson, L'incendie du Chabanais ; le maître de chapelle Casemejor ; le charmant compositeur Louis Dodement, etc., etc.
La principale attraction était l'audition de la diseuse attachée à l'établissement.
Si vous voulez bien faire silence, cria soudain Méryc, vous allez entendre Mlle Diane Andrhée, dans les &œlig;uvres de nos camarades, les bons poètes et chansonniers du Quartier Latin.
Et Mlle Diane Andrhée, une jolie fille, un peu emp?tée déjà, mais l'air ingénu encore sous ses bandeaux plats, roucoula d'une voix légèrement éraillée qui me parut angélique la nouvelle chanson de Delmet, la dernière romance de Gaston Maquis et la récente élucubration de Jules Legay, le pianiste de l'endroit, compositeur aimable et adroit accompagnateur qui savait, quand le chanteur détonnait, le suivre dans ses égarements et le rattraper au point d'orgue quand il se trompait de mesure.
Dans la salle, les braves bourgeois et les jeunes encore timides écoutaient respectueusement ; mais les autres, les habitués, dissertaient ou discutaient un peu bruyamment parfois. Il fallait l'intervention énergique du patron, le père Delfosse, pour rétablir le calme.
Il était près de minuit. Les amateurs que l'on avait coutume de présenter à la fin de la soirée étaient, ce jour-là, peu nombreux.
Méryc s'approcha de nous
- Et vous, jeune homme, me dit-il, devinant sans doute sous le feutre que j'arborais un poète en herbe, et vous, ne nous direz-vous point quelque chose ?
Je me fis bien un peu tirer l'oreille, partagé entre le désir de me produire et la crainte d'être moqué... Mais la vanité l'emporta. Je montai sur l'estrade et, d'une voix mal assurée, je chantai sur l'air A Saint-Lazare, alors en pleine vogue, certaine innocente chanson que je croyais férocement satirique?:
C'est d'la caserne que j't'écris,
Ma pauv' vieill' branche...
Je n'ai retenu qu'un couplet
Les biff's c'est des esprits étroits
Sur qui l'art glisse...
Figur'-toi qu'ils ignor'nt les lois
Du "symbolisse" !
Et qu'on ne pari' jamais, hélas !
C'est c'qui m'consterne,
Ni d' Péladan, ni d' Moréas,
A la caserne !
On applaudit. Vous ai-je dit que l'on applaudissait tout le monde ? J'étais encore tout étourdi par mon succès, quand je vis s'avancer avec déférence un jeune homme blond portant monocle. Il me complimenta congr?ment et me demanda comme une faveur rare, l'autorisation de reproduire ma chanson dans Le Fin de Siècle qui étalait alors, à l'auvent de tous les kiosques, ses pages roses ornées d'affriolants dessins de Paul Balluriau.
Je me mis aussitôt en devoir de faire une copie de mes couplets ; mais, au moment de signer, j'hésitai. J'étais soldat ! Ma petite satire pouvait tomber sous les yeux de mes chefs...
- Signe d'un pseudonyme, me souffla mon ami. Prends le nom d'un copain de bahut.
J'avais eu au collège, pour voisin de classe, un charmant gar?on blond et dodu dont le nom ronflant, adorné d'une particule, m'impressionnait fort. J'aurais renié les miens pour pouvoir porter ce nom sonore et euphonique à souhait : Gabriel de Villemandy !
Pourquoi, à l'instant où je cherchais un pseudonyme, le nom de Villemandy se présenta-t-il à mon esprit ? Je ne saurais le dire. Il fallait faire vite : le rédacteur au Fin de Siècle commen?ait à s'impatienter... Je rempla?ai Gabriel par Georges et, de Villemandy, je fis Millandy, en supprimant la particule, à mon avis tout à fait inutile.
Pendant ce temps, un grand remous se faisait dans le fond de la salle. Le plus célèbre client du Caveau, celui que respectueusement on appelait Maître, le seul à qui Méryc lui-même n'e?t osé imposer silence, Paul Verlaine, venait d'entrer, son chapeau sur les yeux, la tête enfoncée dans un cache-nez, et s'appuyant sur une lourde canne comme sur un b?ton de pèlerin.
Un vieux bohème, d'une malpropreté repoussante, l'accompagnait.
- C'est son "secrétaire", m'expliqua mon journaliste. On l'appelle, au Quartier, "Bibi la Purée".
***
Verlaine avait coutume de descendre ainsi tous les soirs ; vers minuit ; au Caveau du Soleil d'Or, pour y boire une dernière absinthe.
- Viens, me dit tout bas mon ami, on va s'asseoir auprès de Lui !
Verlaine avait vidé son verre et commandait qu'on lui en apport?t un autre.
Le patron crut devoir refuser au poète déjà gris, la drogue qu'il réclamait avec insistance.
Verlaine entra dans une grande colère et, de son b?ton frappant la table comme un enfant rageur, il renversa son verre vide qui tomba sur le sol et se brisa à ses pieds.
Alors, doucement, nous nous approch?mes, et pieusement nous en ramass?mes les morceaux.
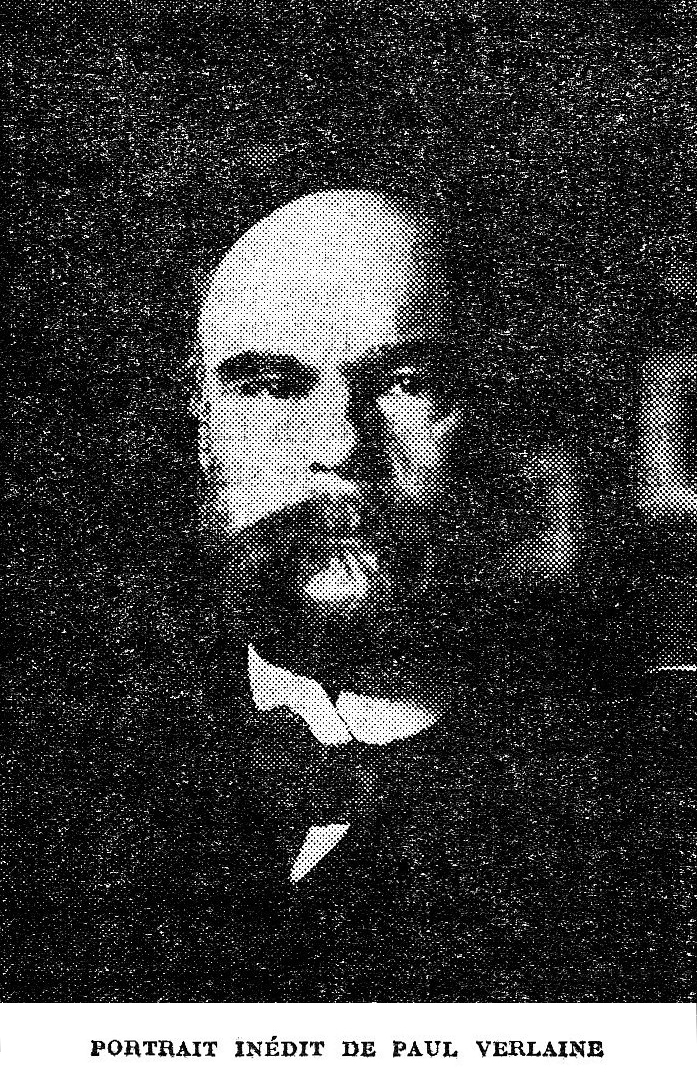
Il "fait soif" déclara mon ami lorsque nous fumes dehors. Je te paye un bock à la Cigarette, rue Racine.
La Cigarette était une de ces nombreuses brasseries qui offraient aux jeunes gens du Quartier Latin, le moyen de tromper leur soif en même temps que leur besoin de tendresse.
Deux serveuses vinrent à nous, souriantes et empressées. Elles portaient, coquettement attachés à la ceinture, de petits sacs en forme d'aumônière dans lesquels elles enfermaient la menue monnaie et quelquefois les jolis louis d'or que, pour prix d'un baiser, leur abandonnaient des clients généreux.
- Vous nous offrez quelque chose ? demandèrent-elles gentiment.
Le moyen de refuser ? Nos serveuses s'assirent près de nous, tout près, plus près encore... Je sus bientôt que la grosse blonde à laquelle s'intéressait mon ami se nommait Georgina. Celle qui m'était échue répondait au nom plus gracieux de Loulou. C'était une jolie brunette aux yeux clairs et dont la peau, d'une éclatante blancheur, faisait plus sombre encore la magnifique chevelure. Sans doute, la poudre de riz et le blanc gras achevaient-ils de donner aux bras dodus de Mlle Loulou, ce velouté qui me troublait d'autant plus qu'elle me permettait de l'apprécier tout à mon aise ; mais je ne cherchais pas à analyser mon plaisir...
Je demandai une menthe verte. Loulou préféra un vieux marc. J'eus la curiosité d'y go?ter. C'était de l'eau sucrée ! La patronne, qui prenait soin de ses intérêts, autant que de la santé de ses pensionnaires, avait imaginé cet innocent stratagème.
Je me sentais maintenant disposé à faire les pires sottises
- Je paye le champagne ! m'écriai-je.
La demi-bouteille co?tait cent sous ! Une folie !...
Hélas ! Mlle Loulou n'était pas libre ce soir-là ... A deux heures du matin, il fallut nous séparer. Des clients moins sérieux, mais moins na?fs, attendaient ces dames sur le trottoir d'en face.
"Tant mieux, pensai-je ; je suis éreinté et l'heure est venue d'aller dormir". Mais mon ami, que le "mousseux" avait un peu éméché, déclara que nous ne pouvions décemment nous quitter avant d'avoir "bouffé" un sandwich chez Bovy.
La boulangerie-p?tisserie Bovy, situé à l'angle des rues Racine et Monsieur-le-Prince, était, après deux heures, le dernier refuge des noctambules. Déjà, des bandes joyeuses envahissaient la boutique. Nous nous mêl?mes aux clients.
- L'alcool, la bière et le vin sont interdits, me dit à mi-voix mon guide ; mais tu peux, si le c&œlig;ur t'en dit, siroter en cachette un petit blanc de derrière les fagots. Il te suffira de demander un thé de la maison. A la barbe des agents on te servira, dans une tasse, un authentique chablis. Je fais ?a tous les soirs !
Je me sentais l'estomac creux. Je crus plus sage et plus prudent de m'offrir une brioche et, résistant énergiquement aux sollicitations de mon compagnon qui voulait à tout prix aller finir la nuit au Grand Comptoir, je me dirigeai bien sagement vers mon hôtel, tandis que des troupes d'étudiants en "vadrouille" et de petites femmes légèrement grises s'empilaient dans des fiacres pour aller aux Halles, manger la soupe aux choux.
II.
Pour embêter l'bourgeois. - Jules Mévisto. - H.-G. Ibels ? L'éditeur Ondet. - Non ami Latruffe. - Le commissaire est bon enfant
éreinté par un voyage de dix grandes heures, je dormis à poings fermés et je fis de beaux rêves... mais, le lendemain, je commen?ai à me sentir le c&œlig;ur gros... Qu'allais-je devenir dans ce grand Paris ? Comment, avec les maigres subsides qui m'étaient alloués, pourrais-je subsister et comment m'y prendrais-je pour me faire connaître, pour réussir, pour arriver enfin ? Il s'en fallut de peu que je reprisse le chemin de ma lointaine Vendée où la vie m'était si douce et où j'avais, ingrat, laissé tant d'affection !...
Paris ! Paris !
O ville inf?me et merveilleuse !
Malheur à quiconque, une fois, a go?té
De tes soirs troublants, l'étrange volupté !...
Soudain, je me rappelai qu'un mien cousin, depuis longtemps déjà devenu Parisien, m'avait toujours témoigné la plus vive sympathie. Le cousin Paul passait, dans ma famille, pour un original et un écervelé. Ne s'était-il pas mis en tête d'aller "faire de la peinture" à Paris où il vivait en compagnie d'une jolie fille, là-haut, à Montparnasse ?
Je supposai qu'il devait avoir de nombreuses relations dans le monde des artistes. Je résolus de l'aller voir... Ah ! le charmant gar?on, comme il sut me réconforter ! Je ne me trompais pas, Paul Aubin recevait dans son petit atelier de la rue Boissonade de nombreux peintres et aussi quelques écrivains. Il me souvient que j'ai rencontré chez lui Eugène Brieux qui n'avait encore rien donné au thé?tre et un romancier dont le premier roman était - depuis quarante ans - sur le point de paraître !... Il fallait attendre l'occasion, disait le cousin Paul qui l'attendait depuis vingt ans !
Cependant j'avais compris qu'il fallait aider la chance. J'avais promis au directeur de l'écho de la Vendée des gazettes rimées : j'allais pouvoir, en tenant ma promesse, m'entraîner, me faire la main. Aussi bien ne me trouvais-je pas suffisamment vengé. "Ah ! j'étais un rêveur à la lune ! un poète ! un nigaud ! On allait bien voir !"
J'avais de bonnes raisons de croire que l'auteur de la réponse à mon poème était un jeune conseiller d'arrondissement qui, de temps en temps, donnait de petits vers au journal bien pensant de ma petite ville. Ce fut à lui que je décochai ma première rosserie?:
Il est un p'tit jeune homme,
Un jeune homm' plein d'esprit,
M'a-t-on dit,
Mais qui parle tout comme,
Comm' s'il n'en avait pas,
Le pauvr' gas.
Et, naturellement, De son boniment,
On s' fiche éperdument..
.
Il n'est qu'un conseiller (bis) d'arrondissement
Quand mourra l'p'tit jeune homme
,
- Car ils meurent aussi,
Ces gens-ci -
Alors que du grand somme,
Dessous, il dormira,
On mettra
Sur son monument,
Ces mots, simplement,
Malicieusement
Il fut un conseiller (bis) d'arrondissement !...
Parfois, haussant le ton, je jouais au pamphlétaire, comme dans cette petite pièce écrite au lendemain de la promenade du B&œlig;uf Gras.
Par la ville tu vas, la tête enrubannée,
Bouffi d'orgueil, heureux de vivre, gras à point,
Et de ce qui t'attend après cette journée,
Pauvre fat, pauvre sot, tu ne te doutes point.
En te voyant passer, mafflu, ventru, je pense
A tel gros arrivé, omnipotent vaurien,
Dont chaque adulateur vient caresser la panse,
Et qui "tout" aujourd'hui, demain ne sera rien...
Tous les deux vous avez pareille destinée?:
Un jour, on vous acclame, on vous couvre de fleurs.
Et puis, le lendemain, la fête terminée,
D'un geste on vous abat... et l'on encense ailleurs !
Grotesques qui passez fiers de votre sottise,
De rubans chamarrés et d'honneurs pleins les bras,
Tel vous assommera qui, ce soir, vous courtise,
Pontifes bedonnants, ventres dorés, b&œlig;uf s gras !...
Cependant mes vers pour embêter l'Bourgeois ne semblaient pas émouvoir beaucoup les Lu?onnais. Je commen?ais à comprendre que je perdais mon temps à ces jeux innocents. Les fins de mois étaient longues... Il fallait me décider à gagner quelque argent.
J'avais, dans le fond de ma malle, une dizaine de chansons. Je décidai d'aller les soumettre à un éditeur. Mais à qui m'adresser ?
à cette époque, les murs de Paris étaient couverts de curieuses lithographies, ?uvres du dessinateur H.-G. Ibels, et qui représentaient Mévisto aîné en costume de moderne Pierrot?: habit mauve et culotte courte. Mes chansons étaient pour la plupart des pierrotreries. L'idée me vint de demander conseil à l'artiste dont je ne sais comment, je m'étais procuré l'adresse.
Il habitait loin du quartier là-haut, rue des Martyrs. L'omnibus Pigalle-Halle-aux-vins m'y conduisit un matin au pas lent de ses braves chevaux. J'arrivai assez tôt pour surprendre Mévisto en plein sommeil. Il me re?ut pourtant de la plus cordiale fa?on et comme je lui disais mon désir d'être édité le plus tôt possible, il voulut bien me conseiller d'aller voir le dessinateur H. G. Ibels et de lui confier le soin d'illustrer mes chansons.
"Quand vous aurez les couverture d'Ibels, me dit-il vous trouverez aisément un éditeur qui sera ravi d'acquérir, en même temps que des chansons qui peuvent sortir, des dessins dont chacun sait le prix."
Je me promis de suivre ce judicieux conseil et, dès le lendemain, je sonnais à la porte du destinateur.
Décidément, Paris n'était pas si cruel aux poètes et les artistes étaient de bien braves gens. Ibels voulut tout de suite m'être utile. Il fut convenu que nous irions ensemble dans le Faubourg Saint-Denis, voir l'éditeur Ondet qui venait de publier des chansons de Gabriel Montoya que H: G. Ibels avait magistralement illustrées.

La maison d'édition Georges Ondet qui devait devenir, gr?ce aux succès de Léon Xanrof et de Théodore Botrel, une des plus importantes de Paris, était une boîte bien curieuse. On y accédait par un étroit escalier en tire-bouchon que l'on avait peine à découvrir au fond d'une cour sombre et humide où l'odeur des détritus se mêlait à celle de l'encre d'imprimerie. Le patron était un homme mystérieux et difficile à saisir. Méfiant et d'une sordide avarice, il semblait toujours craindre qu'on vînt lui demander l'aumône.
Ibels dut longtemps parlementer.
De guerre lasse, Ondet accepta de publier deux chansons.
J'annon?ai fièrement la nouvelle à ma famille. Hélas ! l'effet produit ne fut celui que j'attendais ! Mon père, désespérant maintenant de me voir, de bon gré, réintégrer ma province, mena?ait de me couper les vivres...

"Si j'essayais du thé?tre", pensai-je.
J'avais dans mes cartons un petit acte que je croyais amusant et dont le placement me paraissait facile. Je cherchais par quel moyen je pourrais arriver jusqu'au bureau d'un directeur lorsque, me promenant un jour du côté de la Bastille - que diable étais-je allé faire par là ? - j'aper?us sur une affiche, imprimé en lettres majuscules, ce nom pittoresque?:
LATRUFFE
C'était le nom patronymique d'un petit cabot de café-concert que j'avais connu à la caserne. Latruffe, qui sur l'affiche était qualifié de désopilant, ne manquait pas de talent, et c'était le plus aimable gar?on du monde. J'eus tôt fait de découvrir le thé?tre dont il était à la fois la vedette et le régisseur, là-bas, sur la place de la Nation.
Je pénétrai à t?tons dans la petite salle qu'éclairait à peine la rampe de la scène. En trébuchant parmi les fauteuils, j'arrivai jusqu'à mon ami qui, assis à côté du trou du souffleur, dirigeait la répétition.
- Tu m'excuseras, mon vieux, me dit-il, mais on passe demain ; alors, tu comprends !... On causera tout à l'heure, à la buvette du thé?tre.
Au fond de la salle, une grosse voix grogna "Quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a ?... Il est trois heures. Enchaînons, les enfants, enchaînons.
- C'est le patron, me dit Latruffe. Débine-toi ; et va boire un verre en m'attendant.
Un peu décontenancé, je me rendis au Café du Thé?tre, un zinc peu reluisant où, derrière son comptoir, sommeillait un bistro en tablier bleu. Prés de la fenêtre, un grand gar?on au menton adonné d'une barbiche fumait la pipe nonchalamment. En m'apercevant, il sortit de sa torpeur et me dévisagea longuement... Je le regardai de mon côté, intrigué.
"Quelque confrère...", pensai-je.
Au bout d'un quart d'heure, l'homme à la pipe commen?a à donner des signes d'impatience.
- - Et vous aussi, monsieur, me dit-il, vous attendez ?... Moi, voilà une heure et demie que je suis là ! C'est honteux, monsieur, honteux de faire ainsi "poireauter" les gens !
"Vous êtes peintre, sans doute ?" questionna mon interlocuteur.
- Non, monsieur, répondis-je, je ne suis qu'un modeste auteur... auteur dramatique.
- Alors, c'est pour une pièce ? Eh bien, mon cher monsieur, il en sera de votre pièce comme de mon affiche : on ne la verra jamais !
- Vous êtes pessimiste.
- Je suis furieux, monsieur, furieux ! Quel métier ! Mieux vaudrait cent fois vendre de la mélasse !... Moi, j'en ai assez, je remporte mes croquis.
Il s'était levé, et je compris que sa décision était irrévocable.
- Voulez-vous m'en croire ? ajouta-t-il. Faites de même : remportez votre manuscrit. Aussi bien, ce mufle-là ne le lira jamais... Vous êtes jeune, monsieur, vous avez l'avenir devant vous : vous avez le temps d'arriver.
Il parlait maintenant avec calme.
- Voyez-vous, cher Monsieur, dans nos Sacrés métiers, pour atteindre le succès ; il ne faut pas courir après. Seulement, voilà, il faut pouvoir attendre ; et pour cela il faut commencer par s'assurer le nécessaire, Tenez, vous m'êtes très sympathique.:. Je veux vous rendre un service, un grand service?!:.. Je ne sais pas quelle est votre fortune. Sans doute n'est-elle pas, pour le moment, très brillante. Eh bien ! j e vous ai trouvé une situation !
Je le regardai, interloqué.
- Une situation ?... comme ?a ?...
- Comme ?a ! Mais sortons, cette boîte me dégo?te ! Nous allons prendre le bus. Je paye le voyage. Il m'entraîna dans la rue. Un omnibus passait ; nous saut?mes dedans, et nous grimp?mes sur l'impériale.
Voilà, me dit mon compagnon, de quoi il s'agit. Je suis l'intime ami d'un commissaire de police... du commissaire de la rue des Bons-Enfants. Il est en ce moment très embêté. Son secrétaire a fait des bêtises et on vient de le mettre à pied. Il s'agit de le remplacer.
Je sursautai
Le remplacer ?... Rentrer dans la police !
Mon bienfaiteur me regarda sévèrement.
- Mais, répliqua-t-il, c'est une situation très honorable. Ignorez-vous, Monsieur, que des écrivains notoires sont passés par les commissariats ?
-
Je le sais, répondis-je, et s'il ne tenait qu'à moi... mais ma famille, Monsieur, ma famille jamais ne consentira...
-
Ah ! ces familles bourgeoises ! Eh bien ! envoyez-la promener, votre famille !
Et mon artiste se lan?a dans une longue diatribe contre les provinciaux attardés dans leurs préjugés et encro?tés dans leur hypocrisie.
Nous arrivions sur la place du Louvre.
- Vous allez voir, répéta-t-il, mon ami est un homme charmant. Ah ! il n'est pas un bourgeois, lui !
M. Le Commissaire se montra, en effet, d'une extrême amabilité.
- Vous faites tout à fait mon affaire, me dit-il tout de suite. Je suis s?r que nous nous entendrons à merveille. Et puis, vous portez la barbe : ?a fait sérieux !
Il se mit à rire de bon c&œlig;ur.
Je devrais, déclara-t-il, vous faire passer un petit examen pour la forme... Vous le passerez tout à l'heure, au café, en prenant l'apéritif avec nous... Je vous demande seulement d'être ponctuel et de ne pas rêver à vos chansons pendant les heures de service. Une fois dehors, la journée terminée, vous redeviendrez poète et indépendant. Au surplus, ajouta-t-il, les commissariats sont d'excellentes écoles de philosophie. Vous y ferez de curieuses études et qui vous serviront. Allons prendre l'apéro !
J'exultais ! Cependant, je n'étais pas tranquille. Je promis d'apporter ma réponse dès le surlendemain. Le soir même, j'adressai à mon paternel une longue lettre, dans,laquelle, avec mille précautions, je lui apprenais la nouvelle.
La réponse m'arriva par retour du courrier
"Voilà une singulière idée, m'écrivait mon père ! Comment ! toi qui n'a jamais été fichu de te conduire, tu prétends diriger les autres ?... Tu vas me faire le plaisir de répondre tout de suite à ton commissaire que tu renonces à lui servir de secrétaire. Je ne veux pas que tu fasses un policier. T?che, je t'en prie, de trouver autre chose ! A partir d'aujourd'hui, je t'enverrai tous les mois cinquante francs de plus."
L'aventure finissait, en somme, assez heureusement. Cinquante francs, c'était pour moi la fortune ! J'allais pouvoir faire du feu tous les jours en hiver, et en été m'offrir un demi tous les soirs, à la terrasse du Balzar. Je n'en demandais pas davantage.
Le plus courtoisement que je le pus, je fis connaître à M. le Commissaire la décision que l'on m'obligeait à prendre. Le commissaire était bon enfant. Il ne songea pas à m'en vouloir ; il prit même la peine de m'écrire pour me dire son regret de me voir abandonner une carrière qui s'annon?ait si brillante !
Trois jours plus tard, une bombe anarchiste faisait sauter le commissariat !
Je l'avais échappé belle !
III.
Le Quartier latin de 1893 à 1914. Cafés et tavernes.
Ma chambre d'hôtel me semblait maintenant bien étroite. Je la quittai bientôt, pour aller m'installer dans un petit logement de la rue Racine?: un véritable appartement avec eau et gaz. L'eau était au rez-de-chaussée et le gaz dans l'escalier ! Mais je ne m'arrêtais pas alors à ces menus détails... L'important pour moi, était d'habiter près du Boul'Miche.
De mon balcon, j'apercevais la terrasse du Café Soufflet, dont j'avais fait ma résidence. C'est là que j'ai trouvé mes premiers amis et mes premiers confrères.
Le Soufflet était, à cette époque, le café attitré des Saint-Cyriens, des Polytechniciens et... des petites femmes dont ces messieurs se partageaient les faveurs.
On n'avait pas encore songé à installer des orchestres dans les cafés du Boul'Miche pour y attirer la clientèle bourgeoise. Seuls, le Concert Rouge (lui se trouvait à l'angle du boulevard et de là rue
Gay-Lussac, et le Concert du Cadran sur la place Saint-Michel, permettaient aux amateurs de s'enivrer d'harmonie en même temps que de boissons variées. Dans les autres établissements, les clients se chargeaient de faire eux-mêmes la musique.
J'ai connu les derniers beaux jours du Café de l'Université, qui retentissait des refrains les plus joyeux et les plus scatologiques. C'était là-dedans, jusqu'à l'aube, un chahut indescriptible.
Le D'Harcourt, place de la Sorbonne, n'était pas moins bruyant, et ceux de ma génération ont conservé le souvenir de la petite salle qui se trouvait en contre-bas, au fond du café, et que l'on avait baptisé la "fosse aux lions", à cause, sans doute, des rugissements qu'on y faisait entendre.
Le Café de la Source, ainsi nommé parce qu'au milieu de l'établissement, une dame en fonte s'appliquait à verser quelque fraîcheur dans l'atmosphère surchauffée, était le rendez-vous des joueurs de poker et... des politiciens.
<
Le Balzar, rue des écoles, où trônait Amédée, le patron, ventru et accueillant, était surtout fréquenté par les buveurs de bière qui, tous les soirs, orgueilleusement, entassaient soucoupes sur soucoupes.
Du Steinbach de cette époque, je ne sais pas grand'chose. D'épais rideaux cachaient aux passants la clientèle de choix qui se pressait à l'intérieur. De temps en temps, la porte s'entr'ouvrait pour laisser passer un couple élégant, et l'on avait à peine le temps d'apercevoir les tables couvertes de nappes fines sur lesquelles des buissons d'écrevisses se dressaient auprès des demis mousseux.
Quand nous étions riches - je veux dire un peu moins pauvres ! - nous allions prendre l'apéritif au Vachette, qui était alors le café des étudiants roumains. Nous admirions la coupe impeccable de leurs complets, les reflets de leurs tubes, l'éclat de leurs bagues, et nous enragions de les voir entourés d'élégantes jeunes femmes venues en fiacre de "l'autre côté de l'eau", pour dîner en leur compagnie.
Dans le fond du café, du côté de la rue Champollion, des clients moins élégants, mais plus bruyants, discutaient en se lan?ant des traits comme on échange des horions... J'ai appris plus tard que le Vachette, café de Roumains, était aussi un café de gens de lettres !

Aux environs de 1900, d'importantes transformations furent faites dans les cafés du Quartier Latin. Dans le même temps, de nouveaux établissements s'ouvrirent, qui changèrent quelque peu la physionomie du Boul' Miche. Un magasin de confections qui occupait l'angle de la rue Soufflot et du boulevard, fit place à la somptueuse et affreuse Taverne du Panthéon, tandis que, rue de l'école-de-Médecine, la Taverne Pascal, sous la direction d'un ancien gérant du D'Harcourt, essayait d'attirer les vieux du Quartier et que la Taverne Lorraine, rue des écoles, devenait le rendez-vous des plus joyeux étudiants, en même temps que des rapins et des poètes en herbe.
Le décor de cette vaste brasserie était des plus curieux. Averti par l'expérience, le patron s'était évidemment préoccupé de la solidité du matériel plus que du confort de la clientèle. Toutefois, un certain go?t avait présidé à l'agencement de la salle. Les banquettes étaient de bois, mais de bois verni élégamment incurvé, et sur les murs nus comme ceux de nos bars modernes, de gros chardons d'or se détachant sur le fond bleu d'une draperie légère, formait une fresque du plus heureux effet. Un escalier solide, mais décoratif, permettait d'accéder à une large galerie qui donnait grand air à l'établissement. Dissimulé près de la caisse, un orchestre, qui se voulait tzigane, créait une atmosphère de gaîté propice aux conversations joyeuses.
J'ai connu, à la Lorraine, nombre de jeunes écrivains qui ont fait leur chemin et sont aujourd'hui arrivés : les uns parce qu'ils avaient du talent, les autres parce qu'ils n'allaient pas loin.
A l'heure de l'absinthe, l'heure verte, comme on disait alors, je rencontrais là, tous les soirs : Alphonse Séché, aujourd'hui lecteur à la Comédie-Fran?aise et auteur de nombreux ouvrages soigneusement documentés ; Edmond Hue, que j'ai retrouvé secrétaire de la rédaction de l'Œuvre ; Edouard Pontié, qui a l?ché, et c'est dommage, la littérature pour le sport ; Pierre Bardet, qui "fait du thé?tre" sous le pseudonyme de Barnière ; Robert Francheville, qui a donné des pièces terrifiantes au Grand-Guignol, en même temps que des chroniques d'une folle gaîté aux journaux amusants ; Jacques Auzanet, un délicat poète, aujourd'hui grave fonctionnaire, auteur, avec Mouézy-Eon, d'une pièce en vers, Les Amours d'Ovide, créée à l'Œuvre par de Max.
D'autres encore : Louis Sonolet, intrépide videur de bocks, fécond écrivain et délicieux fantaisiste, dont les collaborations vont de Fantasio à la Revue des Deux Mondes ; Jacques le Lorrain, le poète savetier ; Guy Péron qui, sous le nom de Guy de la Farandole, menait dans les journaux du Quartier un campagne acharnée contre les métèques ; Gomez Carillo, qui devait épouser Raquel Meller ; le poète Caldine, le beau Planès, l'avocat Dours, Jacques Roullet, Jean de Pierrefeu, Jean Varriot, Louis Thomas, etc... Des rigolos : Boileau, qui ressemblait à Kruger ; le pharmacien Vigoureux, l'Auguste de la troupe, et Sanguin de Livry qui, le pauvre bougre ! signa, un jour de cuite, un engagement avec une compagnie coloniale, courut mille dangers et fut finalement mangé par les nègres !
Plusieurs peintres et dessinateurs se joignaient à notre groupe : Petit-Jean, Jacques Villon, Hilaire Larramet, Adrien Barrère.
Barrère me blaguait volontiers et ses plaisanteries n'étaient pas toujours du meilleur go?t. ; mais il avait un indéniable talent, fait de sadisme et de cruauté, d'esprit aussi, parfois.
Plusieurs, parmi les habitués de la Lorraine, ont fait dans le journalisme une brillante carrière Gabriel Alphaud, Camille Aymard, Jacques Patin, Valmy-Baysse, Edouard Dulac, Emile Buré, La Fouchardière, Jacques Landau et... Georges Anquetil.
G. Alphaud est, sans doute, celui que la chance a le plus favorisé.
Un ami commun m'a raconté l'arrivée à Paris de ce Montpellérain, venu comme tant d'autres faire la conquête de la grand'ville.
"Peuh ! murmura-t-il en débarquant sur le quai du P.-L.-M., c'est ?a Paris ?..." Mais, arrivé sur les degrés du grand escalier, Alphaud s'arrêta, mesurant la force du monstre qui grondait à ses pieds, et, levant ' son chapeau dans un large geste : "Paris, pronon?a-t-il, la voix grave, Paris, traite-moi bien !"
Paris a bien traité Gabriel Alphaud. Après avoir été secrétaire général du Temps, il devint directeur de Com&œlig;dia, dont il sut faire le grand journal que l'on connaît. Tous ceux qui furent ses collaborateurs ont été ses amis. Ils le sont restés.
Il y avait aussi, dans la "bande" de la Lorraine, un certain nombre de jeunes cabotins. Je me souviens de Robert Saidreau qui se fit applaudir dans plusieurs revues et finit par devenir cinéaste ; de Coste et de Bouthors, qui furent de l'Odéon, et surtout d'Edmond Roze, qui déjà à cette époque songeait à donner à la mise en scène, cette importance dont nul aujourd'hui ne conteste la nécessité.
IV.
Le Bal Bullier. - Le bar du Panthéon ? La Malpeignée
Les brasseries de femmes avaient disparu. A présent, c'était autour des guéridons, que leur abandonnaient complaisamment les gérants des cafés, que ces dames, en papotant, attendaient le client. Bien rares, étaient les jeunes gens qui s'intéressaient à leur petit commerce. La plupart étaient arrivés à Paris pourvus d'une maîtresse amenée de leur province ; les autres comptaient, pour trouver l'?me s&œlig;ur, sur le hasard d'une rencontre au Bal Bullier où accouraient alors, moins pour y danser que pour y flirter, toutes les gamines émancipées de la rive gauche et du Sentier.
Le vieux bal de la Closerie des Lilas aménagé à l'orientale, tenait de la mosquée et de la pagode, avec ses girandoles de couleur et ses arcades en carton peint. Le décor était ridicule. Mais quand nous
arrivions là, en quête de tendresse, la vieille salle nous paraissait belle comme un palais des mille et une nuits !...
Un orchestre haut en couleur où éclataient les cymbales et rutilaient les cuivres, jetait sur tout cela une gaieté canaille, emportant les danseurs dans le tourbillon des valses et le rythme endiablé des quadrilles, au milieu d'une atmosphère lourde où l'odeur du tabac se mêlait aux parfums grossiers des boniches et des midinettes.
Au risque d'être, à chaque pas, bousculé, on se promenait sur le parquet du bal, comme sur le pavé d'une place publique, tout en pourchassant telle jolie fille peu farouche et vite décidée à venir se rafraîchir sur les balustrades qui entouraient la salle, ou dans les bosquets du jardin propice aux tendres déclarations, voire aux démonstrations moins platoniques.
Des écrivains notoires, des artistes réputés venaient à Bullier se distraire ou peut-être rêver. J'y ai vu Gabriel Lautrec et Curnonsky causant devant une orangeade ; Paul Fort, la mèche rebelle sous le feutre en bataille ; le peintre Marcel Lenoir, Christ de vitrail, égaré dans cet enfer ; le peintre G. Dola, décorateur attitré de la maison, etc. De grands seigneurs prenaient plaisir à venir là s'encanailler : le prince Bolivar Karageorgevitch, le prince-poète M. A. Cantacuzène, diplomate roumain et le prince Troubetskoy, qui montrait, pour les femmes extra-minces, une particulière sympathie.
Soudain, au milieu d'une danse, tout le monde se précipitait dans un coin de la salle ou quelque calicot et quelque commise, jaloux des lauriers de Valentin-le-Désossé et de Nini-Patte-en-l'air, exécutaient les pas les plus inattendus et les "écarts" les plus impressionnants... Et les lazzi se mêlaient aux bravos.

Quand l'orchestre attaquait la dernière polka, l'assaut du vestiaire était un bien curieux spectacle. Le plus souvent, en effet, c'était, dans la cohue, au milieu de l'escalier, que se décidait le sort des soupirants. Parfois, des discussions s'élevaient et des horions étaient échangés... Les agents intervenaient enfin, et le vainqueur sortait, protégé par la police, emportant triomphalement sa conquête... C'était alors la descente joyeuse jusqu'aux cafés dont les terrasses éclairées au gaz nous semblaient briller des feux les plus éblouissants.
A cette heure-là, on ne s'attardait pas au rez-de-chaussée ; on se h?tait d'aller s'asseoir devant les comptoirs des bars américains que, pour suivre la mode, tous les cafetiers venaient d'installer dans leurs établissements.
Ah ! la joie enfantine que nous go?tions à grimper sur les hauts tabourets et à déguster un "pousse l'amour" avec une paille !
Le bar du sous-sol, au Panthéon était le plus fréquenté. A une heure du matin, la fumée y était à ce point épaisse qu'on avait peine à distinguer ses voisins. Que de soirées j'ai passées là, en compagnie d'aimables et joyeux camarades ; Edouard Dulac, Edmond Hue, Henri Yvrard, Jacques Auzanet, Scott de Martinville, Larmandie, Robert Francheville, F. Gravereau, Edouard Pontié et le brave docteur Buret qui m'apprit les vertus de la bière Stout et du même coup, me guérit d'une dyspepsie due, à l'en croire, à l'usage immodéré que je faisais de l'eau de Vichy.
Dans un coin de la salle, un orchestre composé d'un violon, d'un piano et d'un violoncelle (on ignorait le jazz, en ce temps heureux !) répétait durant toute la soirée les scies à la mode et les bostons qui faisaient fureur.
C'est au bar du Panthéon que j'entendis pour la première fois, certaine valse dont je devais faire une chanson devenue populaire : H?tez-vous d'aimer ! La musique était du contrebassiste de l'endroit, un tout jeune homme qui n'avait encore rien publié.
J'avais été frappé par la fraîcheur de la mélodie et je me disposais à m'enquérir du nom de l'auteur, lorsque celui-ci vint, timidement, me prier d'écrire là-dessus des paroles. J'acceptai tout de suite la flatteuse proposition
.
Deux jours après, Schmaltzer et moi, nous portions à l'éditeur Delormel, les couplets de la chanson où je m'étais amusé à paraphraser les vers fameux de Ronsard.

Lancée au Petit-Casino, par le ténorino Henri Dickson, qui était alors la coqueluche des Parisiens et surtout des Parisiennes, H?tez-vous d'aimer ! "porta" dès le premier soir, et tout Paris fredonna bientôt?:
Tant que vous serez jolie,
Ne savez-vous pas, ma mie,
On vous aimera,
On vous fêtera,
On fera pour vous mille folies...
Qui saura jamais à quoi tient le succès d'une chanson !
Le Soufflet et le Pascal avaient aussi leur bar, installé au premier étage. On ne se contentait pas d'y boire, on y dansait, et ce fut là que risquèrent leurs premiers pas (si j'ose ainsi dire !) ces dancings qui devaient faire au Thé?tre, au Music-Hall et au Café-Concert une si redoutable concurrence.

J'ai rappelé, dans un précédent chapitre, que les noctambules trouvaient un dernier asile à la boulangerie Bovy et dans les restaurants des halles ; mais les amoureux, ceux qui, au cours de la soirée, avaient rencontré "l'?me s&œlig;ur", s'esquivaient discrètement avant la fermeture des cafés, tels de jeunes mariés le soir de la noce.
On les retrouvait le lendemain, au restaurant, les yeux battus, les traits fripés par une nuit d'insomnie.
Un déjeuner à un franc quinze payait le plus souvent les baisers re?us. Pourtant, lorsqu'on était riche et généreux, on se "fendait", comme on disait alors, d'un petit cadeau.
Il y avait sur le boulevard Saint-Michel, non loin de la place, un magasin de lingerie où, dans un fouillis inextricable, des jupons, des corsets et des corsages étaient offerts à la convoitise des passants. C'était le magasin de la Malpeignée, bien connu des petites femmes du quartier qui accouraient là, dès qu'elles avaient un louis en poche.
La Malpeignée, ainsi nommée parce qu'elle portait, en broussaille, des cheveux poivre et sel qui lui donnaient l'air d'une tenancière de mauvais lieu, avait au Quartier, une f?cheuse réputation. Ne chuchotait-on pas que dans l'arrière-boutique il se passait des choses...
Je fus un jour amené, à mon tour, chez la Malpeignée par une amie dont je voulais reconnaître les bons soins. J'attendais tranquillement devant la porte qu'elle e?t fait choix du jupon à volants que je lui avais promis, lorsque la matrone s'approcha de moi discrètement
"Vous ne voulez pas, me demanda-t-elle, voir les jolis articles que je cache dans mon petit salon ?..."
à quelles folles orgies me conviait la Malpeignée ? Qu'allais-je voir dans le salon mystérieux ?...
La bonne femme se fit plus pressante?:
"J'ai, en ce moment, un "choix" extraordinaire", me dit-elle, et elle m'entraîna dans l'arrière-boutique... Ce fut pour me montrer des chemises finement ouvragées qu'elle réservait à sa clientèle de luxe...
Je me gardai bien de montrer mon dépit. Au contraire, je me déclarai très flatté d'être considéré comme un client de qualité et, pour paraître tout à fait chic, je fis l'achat d'un superbe corsage de dix-neuf francs quatre-vingt-quinze !
Heureux temps où, avec un louis, on pouvait jouer au grand seigneur et payer d'une chemisette, les faveurs des plus exigeantes !
V.
Au Luxembourg. - Le roi de la bohème
Le Luxembourg était pour moi l'oasis au milieu du pays latin. Je retrouvais là, loin des tavernes, le calme du grand jardin dans lequel j'avais passé mon enfance. Combien de chansons, combien de poèmes j'ai griffonnés à l'ombre des marronniers, distrait seulement par la silhouette de quelque jolie fille qui passait sans détourner la tête.

Le Luxembourg, quand les familles s'en vont vers le dîner qui mijote ; le Luxembourg, quand le sable de ses allées, soulevé par les pas des promeneurs, retombe en poudre d'or, dans le soleil rubescent ; le
Luxembourg quasi-désert où l'on n'entend plus que le pépiement des oiseaux et le battement d'ailes des palombes, à l'heure où ses frondaisons s'estompent dans la grisaille ; le Luxembourg, quelle merveille ! C'est l'instant que choisissent les artistes pour y promener leur rêverie. J'y ai vu Verlaine traînant la jambe, pareil, avec son b?ton, à quelque pèlerin farouche ; Coppée, attardé à regarder les petites ouvrières se h?tant vers leur logis ; Paul Fort, distrait et lointain ; Maurice Magre, insolent, au bras de la belle Manon ; Adolphe Lacuzon, Tristan Klingsor, Jacques Dyssord, tous les poètes...
On rencontrait aussi de bien jolies femmes au Luco, quand j'avais vingt-cinq ans et des illusions.
Gabriel Montoya, qui fut du Quartier avant d'être de Montmartre, a chanté en de plaisants couplets ces Veuves du Luxembourg, que nous suivions dans les allées discrètes, et avec lesquelles nous flirtions autour de la fontaine Médicis, sous l'&œlig;il indiscret du Cyclope.
Soudain, là-haut, sur la terrasse, éclataient les accents martiaux d'une musique militaire ! C'était la phalange de la Garde républicaine qui, conduite par Parès, commen?ait son concert. Et chacun de se précipiter vers le kiosque, pour admirer les beaux messieurs coiffés de bicornes et applaudir Fontbonne, le fl?tiste-solo qui faisait penser au trombone de la chanson?:
Toi, qui connais les hussards de la garde,
Connais-tu pas 1' Fontbonn' du régiment ?

On a fait, dans les ouvrages où il est parlé du vieux Quartier, une large place, une trop large sans doute, à certains bohèmes peu intéressants qui pendant vingt ans traînèrent sur le Boul'Miche leurs guêtres malpropres. Bibi-la-Purée fut le roi de ces gueux sordides. On le voyait déambuler pendant des journées entières, tenant sous son bras une boîte de cireur qui ne contenait qu'une brosse chauve avec laquelle il prétendait faire reluire vos chaussures, au grand dommage d'icelles et de votre pantalon.
Une légende voulait que Bibi f?t un ancien étudiant que l'amour de l'art et des femmes avait conduit à la misère. Au vrai, c'était un triste sire, chapardeur, ivrogne et entremetteur, que la police protégeait parce qu'il servait d'indicateur dans les milieux louches où il parvenait à se glisser.
Bibi-la-Purée ressemblait à Voltaire, dont il avait le hideux sourire. à son temps perdu," il posait comme modèle dans les ateliers de Montparnasse. Son masque étrange avait été remarqué dans diverses expositions, et cela avait suffi à lui conférer une sorte de célébrité. Bibi avait un autre titre de gloire il était le compagnon de Verlaine et peut-être fut-il, pour le pauvre Lélian, un ami plus sincère que tant d'autres qui s'attachèrent à ses pas...
Au lendemain de la mort du poète, j'ai publié, dans le journal Le Procope, les vers suivants qui parurent plus tard dans Com&œlig;dia, sous ce titre : La Muse et Bibi?:
Parmi ce tas d'êtres falots,
Faux bohèmes et camelots
- Oui, camelots d'Art et de Lettres -
Qui le Maître toujours suivant,
Se disaient ses amis, trouvant
Un peu de gloire à sembler l'être ;
Parmi le tas des faux amis,
Qui sur son cercueil ayant mis
Trop de fleurs pour qu'il ne se lève,
Trafiquèrent de ses Bonheurs,
Tinrent boutique de ses pleurs,
Vendirent sa peine et son rêve,
Plus noble c&œlig;ur, apparemment,
Bibi garde fidèlement,
Ainsi que des reliques saintes,
Telles hardes de qui, souvent,
Près de lui se grisa, buvant
Les mêmes trompeuses absinthes...
Bibi, jusqu'à son dernier jour,
Les portera ! Villon, un jour,
L'entendit qui devant Andrée,
Le jurait ; et ce qui fut là
Prétexte à portraicturer la
Binette à Bibi-la-Purée !...

Un curieux dessin de Jacques Villon accompagnait ce poème. On lisait au-dessous, cette amusante légende
:
ELLE. - J'espère, Bibi, que t'en as une belle chemise !...
LUI. - Blaguez pas, Madame ; c'est celle du Maître ! Elle ne me quittera jamais !
A la même époque, Raoul Ponchon, dans une de ses gazettes rimées, chanta, lui aussi, le secrétaire de Verlaine et témoigna de sa tendresse pour le pauvre Lélian?:
Vous le connaissez, ce minable
H?ve, pisseux, déguenillé,
Avec son visage à la diable
à coups de picoussin taillé ?
Bouche en fente de tirelire
Où ne pourrait entrer un sou ;
Avec ?a, le hideux sourire
De Voltaire ou bien de Sardou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme on rit à pleine bedaine
Quand on apprit que c'était là
Le secrétaire de Verlaine !
Et pourtant, il était cela.

Il y eut naguère, au Quartier Latin, un autre bohème qui portait avec plus de dignité le sceptre royal. C'était un grand diable qui, du matin au soir, et du soir au matin, arpentait le Boul' Miche, parlant haut et gesticulant, s'arrêtant seulement pour vous prier, le plus poliment du monde, de lui donner, avec un peu de feu... une cigarette... Il se nommait Biart de Ghérardine et appartenait à une vieille famille bretonne qui, disait-on, le voulait ignorer... Fier de sa naissance, Ghérardine vous montrait complaisamment ses papiers et vous racontait ses malheurs.
- Et puis, concluait-il, je m'en fous ! Je suis le roi de la bohème !
Le roi était atteint d'une douce folie ; il se croyait. selon les jours, artiste peintre, avocat ou globe-trotter... et s'affublait tantôt d'une blouse de carabin, tantôt d'un veston de rapin, d'une toge ou d'un complet de touriste, sans oublier le sac et l'alpenstock!
- Bonjour, toi ! ... vous disait-il familièrement. Excuse-moi, je cours à ma clinique. Dans une heure, je vais opérer une fistule magnifique !
Ou bien?:
Je suis furieux ! Mon tableau a été refusé au Salon ! Ce jury : quel tas de pompiers !
Ou encore?:
Mon vieux, tu ne me reverras pas avant longtemps... Je pars, ce soir, pour faire le tour du monde !...
On le retrouvait le lendemain, sur le boulevard, dans un nouvel accoutrement.
Heureux ce fou qui, chaque jour, se croyait un autre homme et pouvait, chaque matin, faire un nouveau rêve !
Un soir d'hiver, je rencontrai Biart de Ghérardine une valise à la main et vêtu d'un ample pardessus de voyage.
- Bonjour, toi, me dit-il. Je suis pressé ! Je te demande pardon... Je prends le train dans dix minutes.
-
Tu nous quittes ?
-
Oui, Paris me dégo?te !... Il y fait froid. Je tousse. Je fous le camp dans le Midi !
Le pauvre diable partit, en effet, mais ce fut pour le grand voyage ! On apprit, peu de jours après, qu'Albert Biart de Ghérardine venait de mourir à l'hôpital...
Et, depuis, les bohèmes n'ont plus de roi au Quartier Latin !
VI.
Des femmes passent... Une aventure de François Coppée.
Belle dame à la bouche en c&œlig;ur,
A l'énigmatique sourire,
Et dont la poitrine de cire
Orne, dit-on, depuis l'Empire,
La vitrine de mon coiffeur,
Combien de fois, gamin précoce,
Devant vos lèvres de couleur,
Je me suis arrêté, songeur,
Du désir dans mon c&œlig;ur de gosse !
Ah ! vos lèvres rouge-carmin !
Ah! ce sourire de vos lèvres !...
Pendant de longues nuits de fièvres,
J'en rêvais jusqu'au lendemain...
Vous f?tes la première, en somme,
Cruelle à l'enfant que je fus.
Que de cruelles, au surplus,
Quand je me découvris un homme !
Parmi celles que je connus,
Que de femmes à c&œlig;ur de cire !
Ah ! combien, pourrais-je le dire,
M'ont fait l'aumône d'un sourire
Et ne m'ont rien donné de plus ?...
Ces versiculets que publia un jour Fantasio, je les ai griffonnés quand j'avais vingt ans. J'ai connu, depuis, des femmes moins cruelles...
Qu'on se rassure : je ne veux pas raconter ici ma vie amoureuse ! Mais, dans ces Mémoires où je m'applique à montrer quelles influences ont fait de moi, un rimeur de chansons, ne dois-je pas un souvenir à celles qui m'ont inspiré tant de poèmes émus et tant de mélodies attendries ?...
Les plus belles chansons,
C' n'est pas nous, les pauvr's poètes,
Les plus belles chansons,
C' n'est pas nous qui les, faisons !
Je ne parlerai pas de celles qui passèrent... mais il en est une qui, pendant plusieurs années, s'attarda, et dont je veux évoquer les grands yeux étonnés et le sourire ingénu, parce que son souvenir est lié à mes premiers rêves d'artiste et parce qu'elle fut l'héro?ne d'une jolie histoire que je tiens à raconter.
Elle avait vingt ans et répondait comme il convenait au nom de Mimi.
Quand j'allais au fond du faubourg Saint-Denis soumettre à quelque éditeur ma dernière élucubration, je confiais Mimi aux bons soins de la caissière du café Soufflet, une vieille dame très digne qui nous honorait de son amitié. Et c'était, chaque fois, les mêmes prudentes recommandations : "Tu seras bien sage ! Tu ne parleras à personne ! Tu me le promets ?"
On apportait à Mimi des journaux illustrés et, des heures durant, elle les feuilletait distraitement en jetant à tout instant sur la pendule, un regard impatient... Or, un jour que je m'étais attardé plus longtemps que de coutume dans le lointain faubourg, un vieux monsieur entra au café. Il aper?ut Mimi, s'arrêta, hésita, puis se décida à aller s'asseoir à une table voisine...
Cependant, bien sagement, Mimi continuait à parcourir les journaux... Mais le vieux monsieur avait trouvé le moyen d'attirer son attention. Doucement il s'était approché : "L'Illustration... vous permettez ?... Merci !"
Elle sourit. Il s'approcha plus près encore?:
- Vous avez de bien jolis yeux, mademoiselle, dit-il galamment ; vous devez aussi, avoir un joli nom. Comment vous nomme-t-on ?
- Mimi, monsieur.
-
Mimi, c'est charmant ! Vous êtes charmante, mademoiselle Mimi.
-
Oh ! Monsieur...
- Si, si, charmante !...
Ils causèrent. D'abord, le vieux monsieur paria de mille riens : du beau temps, du boa de Mimi, de sa toque d'astrakan qui était de laine... mais ses yeux, si doux tout à l'heure, brillaient maintenant étrangement.
- Voulez-vous me faire un grand plaisir, petite Mimi ? demanda-t-il tout à coup. Venez me voir, chez moi, un jour... bientôt... demain... Nous causerons comme de vieux amis.
Et il glissa sa carte dans la main de la jeune femme.
- Mais, c'est que, dit Mimi en rougissant, c'est que... je ne sais pas si mon ami voudra...
Ah ! fit tristement le vieux monsieur, vous avez un ami ?... Et que fait-il, votre ami ?
Monsieur, il est poète ! Mais, dit-elle, remarquant les longs cheveux du vieil homme, mais vous aussi, monsieur, vous aussi vous êtes poète, peut-être ?...
- Oui... oh ! un peu...
Alors, il se leva, soudain troublé, "tout drôle"
- Rendez-moi ma carte, petite Mimi, dit-il brusquement, rendez-moi ma carte et ne venez pas au rendez-vous ! ... Votre ami est poète. Il ne faut jamais faire de peine à un poète !...
Et il partit...
J'arrivai au Soufflet peu après.
-
Eh bien ! interrogeai-je, tu as été sage, ? Tu n'as parlé à personne?
Mimi rougit.
Non... c'est-à-dire si... Oh ! c'était un vieux monsieur très gentil, avec de beaux cheveux gris coiffés en arrière... Attends ! Il m'a donné sa carte...
Je p?lis.
-
Et tu l'as prise ?
Tout en fouillant nerveusement dans son réticule, Mimi raconta l'aventure : l'empressement du monsieur, sa mélancolie soudaine et son départ attristé ; mais c'est en vain qu'elle chercha le petit carton.
Je l'ai perdu, dit-elle ; mais je me souviens, il y avait dessus : de la Comédie-Fran?aise.
Peuh ! fis-je, quelque cabotin !
Nous partîmes et rentr?mes chez nous... Arrivée dans sa petite chambre, Mimi, en vidant sur le coin de la cheminée le contenu de son sac, retrouva, entre un b?ton de rouge et une houppette à poudre de riz, la carte du vieux monsieur.
Je lus
:
Fran?ois COPPÉE,
de l'Académie Fran?aise.
Si j'avais été moins jeune, moins sot aussi, je me serais précipité le lendemain, rue Oudinot, pour remercier le vieux brave homme, et j'en aurais profité pour lui demander une préface à mon petit volume : Les Frêles Chansons, que je songeais déjà à publier. Mais je n'étais pas un poète pratique. Le deviendrai-je jamais ?
Cette histoire, mon confrère et ami Maurice Hamel l'avait déjà contée dans le Gaulois et mieux que je ne l'ai su faire.
"...Mais qu'est devenue, demandait-il mélancoliquement, qu'est devenue Mimi, la gentille héro?ne de cette galante aventure ?"
Qu'est devenue Mimi ?...
Lorsque tout est fini !... dit la chanson...
VII.
Les cafés littéraires. - Le Vachette ? Le Steinbach. - La Closerie des Lilas. - pensions et gargottes.
Au temps de ma jeunesse, tous les cafetiers du Quartier Latin s'enorgueillissaient de compter parmi leurs clients un homme de lettres notoire. On nous montrait, au Fran?ois-Ier, Paul Verlaine somnolant sur une banquette ; au Café de Cluny, Raoul Ponchon rêvant à la gazette rimée qu'il devait le lendemain donner au Journal ; au Procope, Laurent Tailhade ciselant sa chronique sur la table de Monsieur de Voltaire ; au Café des Arènes, émile Faguet corrigeant les épreuves de sa critique ; à la Source, émile Buré, Zévaès, Charles Le Goffic ; d'autres encore, chez Adolphe, à la Brasserie de la Harpe, etc.
Dans les salons du Café Voltaire, place de l'Odéon, se réunissaient les arrivés et les ratés, les vieux ceux que nous appelions les "bonzes", tandis que les jeunes se retrouvaient là-haut, sur le chemin du mont Parnasse, à la Closerie des Lilas, où officiait Paul Fort qu'un vote quelque peu fantaisiste, dit-on, devait un jour faire prince des poètes.
L'histoire est-elle véridique ? On m'a conté que d'aimables farceurs, voulant faire à Paul Fort, une "bonne blague", étaient venus grossir le nombre des votants et avaient ainsi élevé au rang de prince un écrivain dont ils raillaient la manière et méconnaissaient le talent.

>Qu'importe ! Nul ne pouvait plus dignement porter ce titre, et l'estime en laquelle le tiennent les meilleurs écrivains a depuis longtemps consolé le poète des railleries stupides des méchants et des sots.
Il faudrait couvrir une colonne pour nommer ici tous ceux qui passèrent à la Closerie ou qui y banquetèrent sous des prétextes divers. Mais un livre de Souvenirs n'est pas un palmarès. Aussi bien, les noms des habitués de la maison ont-ils été complaisamment cités dans les nombreux ouvrages consacrés aux cafés littéraires du Quartier Latin.
La Closerie des Lilas (quand on n'y banquetait pas) était un véritable cénacle ; la Taverne du Panthéon ressemblait plutôt à un casino avec ses orchestres, son bar et ses salles de jeu ; mais elle avait aussi son cercle littéraire. On y rencontrait au premier étage Jean de Tinan, de Bruchard, Gustave Fréjaville, Jacques Dyssord, Jean de Pierrefeu, Maurice Magre, le baron de Vitrolles et le chansonnier Augustin Martini, qui attendait son heure en jouant d'interminables parties de poker.
Dans les cabinets particuliers, transformés pour la circonstance en bureaux de rédaction, se réunissait deux fois par an, le Comité des Fêtes du Boul' Miche qui éditait, à l'occasion de la Noël, de la Pentecôte et de la Mi-Carême, une luxueuse publication à laquelle collaboraient, en même temps que quelques étudiants, les jeunes poètes et les chansonniers en herbe.
Là aussi étaient organisées les cavalcades et autres manifestations artistiques.
C'est au Panthéon que, sur l'initiative d'un jeune ingénieur féru de lettres, Henri Sevestre, fut décidée et préparée la reconstitution de la joyeuse fête du Lendit, d'après la peinture murale de J. J. Weeris, l'un des plus curieux ornements de la Sorbonne.
à cette occasion, un concours de poésie fut organisé que j'eus l'honneur de présider. Le premier prix fut remporté de haute lutte, par le poète Gautron du Coudray, avec un rondeau de belle couleur qui rappelait qu'au moyen ?ge, les étudiants s'en allaient chaque année, en joyeux cortège, faire provision de parchemins, à la foire du Lendit, aujourd'hui un carrefour de Saint-Denis. J'en ai retenu les premiers vers?:
Railleurs de joye, hardy ! que l'on desploye
Vostre oriflamme et celle de Mont-Joye ;
C'est le Lendit : basochiens. escholiers,
Suivez Recteur, Prévost et cavaliers,
Sonnez les cors, et foin des rabat-joye.
A Sainct-Denys, où le soleil poudroye,
Allez quérir parchemin et courroge ;
Pardieu1 beuvéz comme des Templiers,'
Bailleurs de joye !
Bien d'autres cortèges curieux égayèrent le Boul' Miche. Les vieux du Quartier se souviennent de certaine Fête des Fous et de l'?ne, pittoresque à souhait, qui eut lieu en 1898. Ce n'est pas sans quelqu'effarement que j'y vis, se tenant à califourchon sur le baudet, et généreusement dévêtue, la jolie maîtresse du jeune maître Pierre Louys, offrant à la foule esbaudie, le spectacle impudique de son corps d'éphèbe,
Mais je n'ai pas trouvé cela si ridicule !


Aux environs de 1900, tous les cafés du Boul' Miche se voulaient littéraires mais seuls méritaient vraiment ce titre : le Vachette, le Steinbach et le Procope, où se réunissaient pour discuter d'art et de littérature les hommes de lettres de la rive gauche auxquels venaient se joindre ceux des Boulevards qui, de loin en loin, abandonnaient pendant quelques heures le Napolitain, le Brébant et le Café Véron.
Le Café Vachette fut à cette époque le plus fréquenté. On y voyait, entourant Moréas hautain et insolent, de nombreux écrivains parmi lesquels plusieurs connaissaient déjà la célébrité.
Ils devaient se retrouver plus tard, à ce Banquet des Amis du Vachette que M. Charles Tardieu eut un jour la pieuse idée d'organiser.
Je ne fus par un familier du Vachette, mais j'ai eu maintes fois l'occasion d'approcher Moréas et de me mêler à ses amis quand, plus tard, il devint un habitué de la brasserie Steinbach où le suivirent la plupart de ses fidèles : Maurice Maindron, René Gillouin, Pierre-Paul Plan, Louis Dumur, Roger Pressat, le docteur Thiercelin, Georges Le Cardonnel, Goldstein, Baragnon, Toulette, Jules Tellier, le docteur Chaumont, le compositeur Gaston Dubreuilh, le dessinateur Doès, le philosophe Meyerson, etc.
On a cité de nombreux mots de Moréas. J'en ai entendu de féroces et d'autres pas méchants.
Un jour que le compositeur Dubreuilh, alors critique musical à Excelsior, discutait avec des amis de la valeur d'un ouvrage que l'on venait de représenter, Moréas coupa la conversation?:
- Dites donc, Dubreuilh, interrogea-t-il, vous qui êtes un homme sérieux, vous croyez vraiment que c'est un art, la musique ?
Mais il faudrait, pour go?ter des mots de Moréas la véritable saveur, retrouver l'accent qu'il donnait à ses boutades.
VIII.
La brasserie Gambrinus ? Le restaurant Larivière ? Le bistro Le Naour
Il y avait aussi au Quartier Latin des restaurants littéraires, je veux dire des restaurants où [que?] fréquentaient des hommes de lettres et des artistes. Qu'il me soit permis de verser un pleur sur leur disparition. Aussi bien, n'est-il plus ridicule de parler sauce et ratatouille depuis que M. Paul Reboux a si spirituellement mêlé les choses de la cuisine à celles de la littérature.
Le premier établissement où je m'aventurai était un restaurant à vingt-trois sous que je ne désignerai pas plus nettement. Je n'ai pas de rancune ! Sachez seulement qu'il se trouvait sur le boulevard Saint-Michel et qu'il y sévissait encore il y a peu d'années.

Je tiens à accorder aussi, un souvenir à la pension Salé qui, à l'exemple de la pension Laveur, permettait aux jeunes bourgeois de ma génération de dépenser au café, ou d'abandonner à leurs petites amies, les sommes que, pour vivre, leur octroyait leur papa. Salé attendait patiemment, pour réclamer l'addition, que son pensionnaire f?t devenu notaire, avocat, médecin ou percepteur.
Il suffisait pour conserver l'estime du patron - m'avait-on dit - de donner un petit acompte, en même temps qu'un petit pourboire à Augustine, la serveuse, lorsque celle-ci, à la fin du mois, glissait discrètement la "douloureuse" sous votre serviette.
Je déjeunais et dînais à l'&œlig;il chez Salé depuis plusieurs mois déjà, lorsqu'un jour, trouvant sans doute insuffisants les acomptes versés, le maladroit gargotier s'avisa d'envoyer à ma famille le montant de la petite note. Brave monsieur Salé ! Bénis soient sa sottise et son geste imbécile ! Le facteur m'apportait le lendemain les justes remontrances de mon père indigné. Je n'osai reparaître à la pension et me passai de dîner.
Vers deux heures du matin, je me décidai à entrer au Café Procope où l'on vous servait, pour un franc, un succulent souper composé de deux &œlig;ufs au jambon ou d'une choucroute garnie avec un demi et du pain à discrétion. J'arrosai le tout d'un café à la Voltaire, savoureux mélange de café et de chocolat. Ah ! le bon repas ! J'exprimai à haute voix ma reconnaissance au gar?on estomaqué. Un quart d'heure plus tard, j'étais le meilleur ami du patron, à qui je contais mon aventure et confiais mon embarras. Le brave homme eut tôt fait de me consoler. "Vous êtes ici chez Procope, me dit-il ; la maison est ouverte à tous les artistes. Votre couvert sera mis tous les jours, si tel est votre bon plaisir. Vous paierez plus tard... quand la gloire sera venue." La Gloire !...
Que n'ai-je accepté l'aimable proposition ! J'aurais sans doute, évité la f?cheuse gastrite qui fit de moi, pendant si longtemps, un client insupportable ! Durant vingt ans, je fus la terreur des traiteurs du Quartier Latin. Dans la plupart des restaurants, je n'ai fait qu'un repas et suis parti avant le dessert en jetant ma serviette au nez du gérant. Dans quelques autres, je me suis attardé pendant une semaine. Il en est trois où l'on m'a supporté pendant des mois entiers et dont j'ai conservé un souvenir ému : la Brasserie Gambrinus, le Restaurant Larivière et le Bistrot Le Naour.
Le plus curieux était le Gambrinus, voisin de l'Odéon, et que dirigeait le père Mansuy, assisté de ses deux filles. Ces demoiselles étaient charmantes, et l'on avait coutume d'aller faire avec elles un brin de causette à la caisse, tandis que le patron préparait les hors-d'&œlig;uvre nombreux et variés et les salades de pommes de terre "avec ou sans oignon" destinées, sans nul doute, à vous couper l'appétit.
On rencontrait au Gambrinus, au temps où j'y prenais mes repas, de- nombreux auteurs dramatiques : Paul Gavault, André de Lorde, Jean Richepin, Pierre Elzéar, Mouézy-Eon. On y voyait aussi Saint-Saëns, les frères Tharaud, Philippe Berthelot, les directeurs Marck et Desbeaux, Ginisty, Mgr Baudrillart, alors simple professeur à l'Institut Catholique ; Oudot, le directeur de l'hôpital Saint-Louis, et le peintre La Gandara qui venait là déjeuner en voisin, avec ses modèles...
Des artistes de l'Odéon : Duard, Grétillat, Bernard, Chevillot, Dorival, y faisaient une apparition entre deux actes, pendant les répétitions. J'y ai aper?u, à l'heure du souper, Segond-Weber, Tessandier, Le Bargy, de Max, grand amateur de bisque aux écrevisses, et Mary Marquet, alors élève au Conservatoire, toujours flanquée de son père et de sa mère qui, tous les deux, opéraient au thé?tre d'à côté.
Le Gambrinus avait connu jadis une ère de prospérité, et le père Mansuy évoquait avec émotion le temps où les fêtards du Quartier venaient, en sortant du Médicis, la brasserie voisine, boire chez lui le champagne en mangeant des écrevisses.
Une douzaine de pauvres bêtes, prisonnières dans un aquarium, étaient encore offertes, à la porte de la brasserie, à la gourmandise des clients ; mais le prix de ces sympathiques crustacés avait déjà, à cette époque, singulièrement augmenté, et les malheureuses bêtes mouraient de vieillesse et d'ennui, en attendant l'heure du court bouillon !
Le père Mansuy était d'une complaisance extrême. Je ne pouvais manquer d'en abuser. C'est en vain qu'il accumulait les hors-d'&œlig;uvre et veillait lui-même à la confection des plats péniblement choisis : il n'arrivait pas à me satisfaire. A la fin, sa patience se lassa. Après quelques réponses timides à mes observations, un beau jour il se f?cha pour de bon, et je dus quitter la place...
Après quelques expériences, chaque fois payées par de nouvelles crampes d'estomac, je devins client du Restaurant Larivière. Ce n'était alors qu'un modeste "chand de vins" qui faisait le coin de la rue Monsieur-le-Prince et du Boul'-Miche. Je n'avais que le boulevard à traverser quand je conviais à dîner une petite femme du Panthéon.
De nombreux artistes qui passaient pour des gourmets venaient dîner chez Larivière. J'y ai vu souvent Paul Mounet qui avait coutume de se faire servir une petite terrine de foie gras dont il enlevait
délicatement la graisse pour confectionner ensuite, lui-même, deux &œlig;ufs sur le plat qu'il dégustait avec un plaisir évident. J'y ai rencontré aussi Moréas. Il était - Dieu me pardonne ! - plus difficile et plus exigeant que moi ! Je l'entends encore gourmander le gar?on de cette voix arrogante qui faisait trembler la cuisinière et gla?ait d'effroi la patronne : "Gar?on, éloignez de moi ce bifteck ! Il est sinistre !"
Je désespérais de découvrir, au Quartier, une maison où je fusse assuré de trouver une cuisine de mon go?t, lorsqu'un soir quelqu'un qui me voulait du bien m'entraîna chez un petit "bistrot" de la place de la Sorbonne, au Restaurant Le Naour. "Essayez-en, me dit-il : le décor n'est pas brillant, mais le b&œlig;uf-mode y est excellent !"
La maison Le Naour n'était pas, en effet, d'un aspect bien engageant ; mais quel délicieux fumet vous montait aux narines dès que l'on en franchissait le seuil ! Et comme elle était sympathique en sa simplicité, cette petite salle réservée aux pensionnaires, où Mme Le Naour en personne assurait le service !
Autour d'une table ronde que dix assiettes pouvaient couvrir, on trouvait le moyen d'asseoir vingt clients heureux de faire honneur au gigot bretonne et aux pommes rago?t.
J'ai connu là de vieux étudiants, aujourd'hui mariés et "établis" en de lointaines provinces ; un peintre sans le sou, devenu millionnaire ; un éditeur spécialisé dans l'édition des farces, attrapes et surprises ; une mignonne dactylo ; une femme légère et un poète charmant et quelque peu romantique, Edouard Révérand, qui venait de publier son premier livre de vers : Minuit, heure du crime ! On entendait, dominant le bruit des conversations joyeuses, des ordres étranges : "Un haricot juteux, sans jus ! Un !" Cela signifiait, pour les initiés : un haricot m&œlig;lleux sans jus de viande.
Un puriste, qui était aussi un connaisseur, prétendait parfaire l'instruction de la serveuse en réclamant un gruyère, un vrai ! un gruyère avec un i grec et des trous !
Mme Le Naour intervenait, maternelle?:
Tu ne manges pas de dessert, toi, Paulette ?...
Je n'ai plus d'argent, madame Le Naour !
?a fait rien, tu paieras une aut' fois. Go?t'-moi c'te crème, ma fille, tu m'en diras des nouvelles !
Mme Le Naour était la Providence des petites grues et des pauvres diables.
Ah ! la brave femme !
Quelquefois, un monsieur "très bien", las des nourritures infâmes des grill-rooms et des palaces, entrait dans le petit restaurant, heureux de pouvoir déguster un honnête pot-au-feu, ou un authentique poulet à la broche. Accroupi derrière son comptoir, le père Le Naour, vieux Breton stupide et mal embouché, regardait d'un mauvais &œlig;il ce "môssieu à manières" égaré là. Le malheureux s'avisait-il de frapper sur son verre pour appeler la serveuse ?
Le Naour surgissait, rouge de colère.
-
De quoi ? De quoi ? Monsieur s'est trompé, sans doute ? Le D'Harcourt, c'est à côté. Ici, on n'appelle pas les gens comme des chiens !
Et il refusait de servir ce client malappris !
Nous connaissions le bonhomme et nous nous gardions bien de jouer, avec lui, au grand seigneur.

Le Naour, lui aussi, aurait pu se flatter d'être le traiteur des écrivains et des artistes ; mais il n'y songeait guère... Parmi les nombreux "gens de lettres" qui prirent pension chez lui, le plus célèbre et le plus pauvre fut sans doute Paul Verlaine. Le poète qu'au risque d'entendre le patron il trouverait là le dîner qu'il n'eut pas osé aller emprunter ailleurs. Quand arrivait l'addition,c'était le plus souvent un bout de papier qu'en guise de monnaie, il portait à la caisse, un bout de papier sur lequel il avait griffonné une ballade, un sonnet ou une ode à la gloire de la bonne hôtesse.
Quéqu' voulez qu'j'en fasse de votre chanson ? grommelait le Naour, ?a vaut pas un billet de banque, bien s?r.
Prends le quand même, répondait Verlaine. ?a vaudra peut-être davantage plus tard...

Un jour, la patronne nous a pris avec des larmes dans la voix, que son "bonhomme", fatigué, avait décidé de vendre la baraque. Nous rest?mes concernés, comme à l'annonce d'un malheur. En vain. Nous essay?mes de faire revenir sur cette décision le Breton têtu. Le Naour nous déclara que c'était chose faite?: le restaurant était vendu et allait avec la "bourgeoise" s'en aller planter ses choux là-bas, dans son pays.
Je me rappelais alors les confidences que m'avait fait un jour le bonhomme.
Des papiers de Monsieur Verlaine, j'en ai un plein tiroir, m'avait il dit.
Un soir que nous buvions ensemble le dernier vieux Rome, je lui demandais, à br?le-pourpoint.
Et tous ces poèmes que Berline vous a donné vous n'y tenez guère, j'en suis s?r. Vous ne devriez pas m'en faire cadeau ?
Le Naour, parti d'un gros rire?: "Ah ! les sacrées paperasses j'allions pas les garder bien s?r! Hier, j'ai foutu tout ?a au feu."
La brute !... J'en ai pleuré.
IX.
Le café Procope. - Une lettre de Huysmans.
Le Café Procope fut sans doute le plus ancien café littéraire du Quartier Latin. Les historiens en font remonter l'origine à 1686 mais c'est seulement en 1695 qu'il devint le rendez-vous des écrivains, et des beaux esprits.

On a écrit de nombreuses histoires du Procope, et j'ai publié moi-même, dans la revue : La Table Ronde,
de curieuses notes laissées par Théo Bellefonds, l'un des fondateurs de la Société historique du Sixième arrondissement, et le dernier patron du célèbre café.
C'est en les parcourant que j'ai appris a que la boutique de Procopio di Coltelli, qui portait l'enseigne : Au Saint Suaire de Turin, ne fut pas le premier endroit où l'on but du caffé, mais le premier "cabaret" où l'on servit le breuvage cher à M. de Voltaire. Il était apporté sur des plateaux, ainsi qu'en témoigne une vieille grature - par des enfants que l'on appelait "petits gar?ons". Ceux-ci furent, plus tard, remplacés par des serveurs plus ?gés, mais le nom resta.
J'ai chez moi bien d'autres documents que le fils de Théo, M. Gabriel Bellefonds, a bien voulu me confier, et entre autres pièces précieuses, des poèmes autographes de Paul Verlaine, de Laurent Tailhade, de Paul Arène, d'Edouard Dubus et d'Emmanuel Signoret, etc., ainsi que des lettres, des cartes d'invitation, des programmes et de nombreux articles qui font justice des erreurs grossières que l'on trouve dans plusieurs ouvrages et dans certains prétendus Souvenirs écrits par des gens qui vraisemblablement, n'ont jamais mis le pied au Procope.

Depuis longtemps, le célèbre café avait fermé ses portes, et nul n'était venu troubler les grandes ombres qui erraient dans les salles silencieuses, lorsqu'en 1893, Théo Bellefonds eut l'idée d'ouvrir en ces lieux, où tant d'écrivains jadis avaient fréquenté, un café en tout semblable à celui d'autrefois, et de convier à venir s'y rafraîchir, en discutant d'art et de littérature, les poètes et les artistes de la jeune génération.
Fils d'un libraire du Berry, Théo avait appris à gaufrer le cuir chez Capet. Des clients du maître relieur, Carpeaux et Jean Garnier, s'étaient intéressés à lui. Mêlé de bonne heure à la bohème du Quartier Latin, il s'était lié d'amitié avec de nombreux artistes, écrivains, peintres et sculpteurs.
Marié, Théo rêva un jour d'unir la limonade à la littérature. Bibliophile érudit, il connaissait mieux que quiconque l'histoire du vieux café Procope. Il décida de le ranimer, et pour le reconstituer exactement, fit appel au talent des uns, s'inspira des conseils des autres.
Deux jeunes peintres, P. Thomas et J. Fenlein, furent chargés de la décoration. Des panneaux représentant les plus célèbres clients de jadis : Voltaire, J.-J. Rousseau, Robespierre, Diderot, Danton, Marat, Mirabeau, Gambetta, remplacèrent les simples médaillons qui ornaient les murs. Des toiles signées Corot, d'Aubigny, Vallon, Courbet, Willette, R&œlig;del, etc., furent accrochées ci et là.

Dans la salle qui s'ouvrait au fond du café, et que l'on décida d'appeler le salon, fut installée la table de Voltaire. "La table devant laquelle l'illustre écrivain avait coutume de s'asseoir, écrit Théo, avait toujours été l'objet de la vénération des clients du Procope". "Quand moururent certains habitués du café, on la transforma en une sorte d'autel sur lequel, devant le buste du mort, br?lèrent des lanternes voilées de crêpe.
"Pendant la Révolution, Hébert, monté sur elle, haranguait le peuple à la porte du Procope et l'excitait à arracher des mains des crieurs les journaux qu'ils distribuaient. Très violent et doué d'une force peu commune, le conventionnel, pendant une harangue, brisa d'un coup de botte le marbre de la table fameuse.
"Les morceaux en furent pieusement scellés."
Sur les panneaux d'une porte du vieux Café, conservée malgré la transformation qu'avait subie l'établissement, Théo fit inscrire en lettres d'or les noms des hommes célèbres qui avaient fréquenté chez Procope. D'un côté, on pouvait lire ceux de Voltaire, Piron, Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Condorcet, Danton, Marat, Bonaparte, Talleyrand, Robespierre, Gambetta ; de l'autre, ceux de J.-B. Rousseau, Fréron, J.-B. Rousseau, l'abbé Prévost, Grimon, La Harpe, Beaumarchais, Mirabeau, Camille Desmoulins, Hébert, Fabre d'églantine, A. de Musset, Paul Verlaine.
Les petits carreaux imités de ceux du temps, les tables élégantes faites sur le modèle de celle de Voltaire, les lustres anciens et les glaces qui reflétèrent tant de visages célèbres, devant lesquelles sourirent tant de jolies comédiennes, achevaient de donner au vieux café la physionomie qu'il avait autrefois.
Le Procope restauré ouvrit ses portes en septembre 1893. Théo annon?a l'événement en envoyant à tous les artistes et gens de lettres parisiens la lettre suivante?:
"Le Café Procope, endormi depuis si longtemps, se réveille et désire être, comme autrefois, l'auberge des esprits amoureux de choses artistiques et littéraires.
"Ce café a été restauré avec le plus grand souci des traditions, afin de favoriser les intimités et les rapprochements intellectuels. "à l'occasion de la réouverture du Café Procope, permettez-moi, Monsieur, de vous inviter à un Lunch cordial qui aura lieu vendredi, 15 septembre courant, à 10 heures du soir, veille de l'ouverture publique."
"PROCOPE THÉO, successeur."

Au lendemain de cette soirée d'inauguration, de nombreux écrivains, parmi lesquels Edouard Pailleron et J.-K. Huysmans, adressèrent au cabaretier-artiste les lettres les plus flatteuses. Voici celle de Huysmans, qui fut publiée dans le premier numéro du journal Le Procope, paru le 30 octobre 1893
"Paris, le, 9 décembre 1893.
"Cher Monsieur,
"C'est d'une belle carrure que de vouloir prendre le public à rebrousse-poil. Il faut aujourd'hui des murs peints en crème, des divans qui glissent, des porte-allumettes ceinturés de réclames, des verrières inf?mes. Vous pouvez vous flatter, au moins, de n'avoir pas, avec votre intéressante reconstitution, chatouillé le 'Mufle'.
"Vous mériteriez donc d'échouer ; mais il n'est point de règles sans exception, et il est nécessaire que vous la soyez, cette exception, et il faut qu'en plein goujatisme, votre tentative vive et réussisse pour protester contre les abominables décors qui nous entourent.
"Personne ne le souhaite plus que moi, cher Monsieur, et à ces vieux je joins une bonne poignée de main."
"J.-K. HUYSMANS."
Ah ! que mon vieux Procope ressemblait peu à ces hideux cafés-bars, où l'on consomme en h?te, comme si l'on avait honte de s'y montrer, et qu'il faisait bon s'y attarder et y perdre son temps !
Entrés au Procope à deux heures de l'après-midi, nous y étions encore aux premières heures du matin. Et Théo, le "troquet-artiste", comme l'appelait R&œlig;del, ne parvenait pas toujours à nous éloigner à l'heure de la fermeture. On baissait la devanture, on éteignait les lampes et la discussion continuait aux chandelles !
J'entends encore la voix fl?tée de Fernand Hauser, aujourd'hui rédacteur au Journal, se mêlant à celle plus grave du poète André Escourrou, et je revois l'ineffable M. Parfait, tiré à quatre épingles, et, à soixante-quinze ans, plus coquet qu'un jeune homme, jouant aux dominos avec Théo ou Jacquemin.
Là-bas, discutaient les poètes : Yvanhoé Rambosson, Achille Segard, Han Ryner, Em. Signoret, Edouard Dubus, Gustave Le Rouge, Henry Degron, érasme, Parion, Emile Boissier, René de la Villoyo, André Ibels, Alphonse Séché, G.-M. Savarit, G. Guitton, H. Vernot, P. Souchon, G. Brunot, Mécislas, Goldberg, Pierre Mestro, Dufour, Lepage, Jules Moulin.
Dans un autre coin, Adolphe Gensse, Alcanter de Brahm, A. Cazals, Frédéric Boutet, Camille Girault, Alcib Mario et Paul Weill faisaient des mots.
Les peintres Thomas, Fenlein, E. Vibert, Barrière, Em. Causé, R&œlig;del, H. Pille, Grigny et les sculpteurs E. Jetot, Niederhausen couvraient de croquis le marbre des tables.
De Bucé, directeur de la Revue d'un passant ; Georges Elear, directeur de La Cloche ; John Macdonald, correspondant de la Salurday Review, prenaient des notes.
A l'écart, le père Poussin, l'auteur des Versiculets, seul devant un bock, maugréait, tandis que dans le petit salon, sur la table de "Monsieur de Voltaire", Laurent Taiihade terminait en h?te son article. A côté de Verlaine venaient souvent s'asseoir : Paul Arène, Adolphe Retté, Oscar Wilde, Jean de Tinan, Rachilde, Huysmans, Charpentier, Raoul Ponchon.
Cependant on grattait à la porte : c'était Bibi-laPurée. Bibi ! roi sordide des bohèmes. Son masque voltairien apparaissait dans l'huis entre-b?illé ; il venait nous prévenir que le soleil commen?ait de se lever derrière l'Institut et qu'il était temps de s'aller coucher...
X.
Le journal parlé ? L'absinthe.
Le premier soin des nouveaux clients du Procope fut de fonder un journal qu'ils intitulèrent Journal Parlé.
Théo écrit dans le premier numéro
"Le journal qui prend ce titre : Le Journal Parlé du Café Procope, abandonné depuis 200 ans, a pour but de faire renaître les intimités et les rapprochements intellectuels, et de traiter de toutes questions d'art et de littérature.
"Ce titre sera tout naturellement justifié par ce fait qu'une Parlote, existant déjà au Jardin du Luxembourg, se transporta au Café Procope lors de sa fondation, en 1689. - Chacun y apportait les nouvelles verbales cueillies aux quatre coins de Paris, répétées et commentées ensuite dans toute la ville, et plus tard affichées manuscrites sur le tuyau du poêle du Café.
"Le Journal Parlé, dit Cailhava, s'était substitué aux anciens Journaux des Perruquiers dont les boutiques servaient de rendez-vous aux oisifs campagnards de bon ton qui allaient s'y calamistrer et y raconter, avant l'invention des cafés, les nouvelles et les historiettes du jour."
Jacquemin, grave professeur au Muséum, fut désigné pour remplir l'office de secrétaire de la rédaction. Il convient de faire remarquer, pour expliquer ce choix, que le digne homme devenait, quand il avait terminé son cours, le plus joyeux et le plus spirituel des humoristes.
Je devais, en mars 1896, être "bombardé" rédacteur en chef de la petite feuille. Entendez qu'à cette date, le patron me chargea d'assurer, en même temps, les fonctions de chroniqueur, d'échotier et de critique ! Théo comptait heureusement, parmi ses collaborateurs, des écrivains éminents : Paul Verlaine, Paul Arène, Laurent Tailhade, Charles Cros, etc. à côté de ces signatures qui donnent à la collection du journal parlé Le Procope un prix inestimable, on trouve, avec une curiosité amusée, les noms de jeunes hommes de lettres qui ont acquis une juste notoriété : Fernand Hauser, André Ibels, Gustave Le Rouge, Marc Legrand, P.-Paul Plan, Louis Dumur, Henri Parion, Charles Quinel, Yvanhoé, Rambosson, Achille Ségard,. C.-M. Savarit, Adolphe Gensse, etc.
Parmi les poètes dont le talent ,déjà s'affirmait, beaucoup, hélas ! ont été enlevés à notre amitié Emile Boissier, Henri Degron, Alfred Dalibard, Andhré Joyeux, Jacques Le Guillin, Mecislas Golberg, Camille Girault, René de la Villoyo, Emmanuel Signoret, André Escourrou, Pierre Trimouillat, Charles Morice et le charmant Edouard Dubus, l'auteur de ce joli volume : Quand les violons sont partis..., dont nous aimions l'ironie légère et le talent délicat.
Les dessinateurs A. Barrère, Emile Causé, H.. Pille, Thomas, Vibert, Cazals, R&œlig;del, Félix Regamey, Jacques Villon, J. Fenlein, etc., illustraient les poèmes et les fantaisies de leurs camarades.
Le premier numéro du journal contient une curieuse chanson de F.-A. Cazals, à la gloire du Café Procope?:
Entre l' pont des Arts et l' Sénat, (bis)
Un café-crème et chocolat, (bis)
A deux pas de la "Bott' de paille",
Rouvre ses port's à la ripaille.
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment,
L' Procope est un café charmant !
Dans ce Café qu' Théo dora, (bis)
Naguère on voyait Gambetta (bis)
Fumer, cracher comme un cratère,
Devant la table de Voltaire.
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment,
L' Procope est un café charmant !
>L'on n'y a pas encore, hélas ! (bis)
Aper?u le beau Moréas ; (bis)
C'est bien dommag' car Apocope
Rim'rait si bien avec Procope !
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment,
L' Procope est un café charmant !
Les jeunes de cette époque n'avaient pas pour leurs a?nés plus de respect que ceux d'aujourd'hui, et le Procope est rempli de traits décochés aux écrivains arrivés qu'il était de bon ton de trouver raseurs et pompiers.
Au lendemain de son échec à l'Académie, Emile Zola était blagué de joyeuse fa?on par le chansonnier Georges Brunot
C'était un homm' de Lettr's pauv' gas,
Et lon lon laire! Et lon lon là !
C'était un homm' de Lettr's pauv' gas,
Dont l'Académie n' voulait pas !
Elle lui dit : 'Apport' moi d'main,
Et lon lon laire! Et lon lon là !
Elle lui dit : 'Apport' moi d'main,
Un ouvrag' pur' moral et sain."
Zola écrit le Rêve et va, de nouveau, frapper à la porte de la "Cruelle"?:
"Mais l'Académie lui dit : 'Non,
J' te r'cevrai pas dans mon giron !
Alors vers l'Itali' partit
Et Ion, Ion, laire !
Et Ion, Ion, Ion, là !
Alors vers l'Itali' partit,
L' pèr' des Rougon-Maquart !... honni !"
Gensse, qui parodiait volontiers le poète des Humbles, avait annoncé la publication d'un Coppée Intime et se vantait d'avoir re?u cet amical billet?:
Hier, sur le tramway Louvre-Trocadéro,
J'ai pu causer avec le chansonnier Giro.
Votre ami, d'un talent musical que j'estime,
M'a dit que vous alliez faire "Coppée Intime" ;
Je vous adresse ici tous mes remerciements,
Mais tiens à vous donner quelques renseignements.
Bourgeois de bonnes m&œlig;urs, quoique célibataire,
étant plutôt l'ami de mon propriétaire,
Je n'ai jamais quitté mon petit pavillon
De la rue Oudinot. j'y vois le papillon
Flirter avec la rose, y chercher l'ambroisie,
Et je respire un air chargé de poésie.
C'est pour cela qu'en écrivant, j'ai ce travers
D'ignorer si je fais de la prose ou des vers...
Barrès n'était pas épargné. Sous ce titre : L'Echec de Monsieur Barrès, F.-A. Cazals lui décochait sept malicieux couplets?:
Tout l' temps que Barrès fut député,
Il a toujours très bien voté,
Mais comme il était boulangiste,
Et qu'imitant feu le grand ROI,
Il disait :
'D' l'?m' l'Etat c'est l' Moi!'
On le prenait pour un fumiste.
En ce temps-là, comme aujourd'hui, il suffisait d'avoir quelque succès pour être criblé d'épigrammes.
On lisait, dans le numéro de janvier 1895, sous la signature de Dubus, cette fantaisie écrite selon l'expression de Tailhade "en dérision du grotesque Jean Rameau", qui sévissait alors dans les salons?:
Mon cher ami, quand je mourrai,
Plante Jean Rame au cimetière.
Je hais son postiche éploré
Qui danse à sa voix d'ours - et chère !
Mais son &œlig;uvre sera légère,
A la terre où je dormirai !
Laurent Tailhade lui-même exer?ait sa verve caustique aux dépens du poète à la mode. J'ai sous les yeux une petite chanson rosse écrite de sa main, et qui porte cette indication : "Air : Les Cerises."
Lorsque Jean Rameau s'appelait Labète
Il était beaucoup plus intelligent.
Il faisait la quête,
Chez les petits "veaux" qu'avaient des pépètes,
Il allait parfois glaner des argents.
Lorsque Jean Rameau s'appelait Labète,
Il était beaucoup plus intelligent !
Tailhade chansonnier ! Qui s'en doutait ?...
C'est à ces jeux innocents que les habitués du Procope occupaient leur temps.
Mais à côté de ces fantaisies "pas méchantes", combien de poèmes charmants dont leurs auteurs, eux-mêmes, ne se souviennent plus aujourd'hui, et que ne pourraient relire, sans émotion, j'en suis s?r, ceux qui jadis les griffonnèrent, à l'?ge des espoirs et des illusions.

Bien que le breuvage qui fit la fortune de Procoprio fut l'objet des soins attentifs de son successeur, les poètes du Procope célébraient plus volontiers l'absinthe que le café... Sans doute, parce qu'à l'exemple de Verlaine, ils en faisaient un grand usage.
J'ai retrouvé dans les papiers laissés par Théo, plusieurs manuscrits où la verte liqueur est chantée en vers dithyrambiques et déclarée la grande consolatrice.
On connaît les vers d'Edouard Dubus qui partirent, pour la première fois, dans le Procope?:
Quand s'appesantira sur toi le mal de vivre,
Quand tu seras comme un vaisseau désemparé,
Ne clame pas au ciel sourd un miserere,
Mais bois-moi de l'absinthe à pleins verres. Sois ivre!l
Par les trottoirs déserts, la nuit tu vagueras,
e raccrochant aux becs de gaz, croyant, peut-être,
Aux sons d'un piano tombés d'une fenêtre,
Que tu danses avec ton rêve dans tes bras.
Tous ceux qui ont fréquenté les caveaux du Quartier Latin aux environs de 1900, ont entendu Alfred Dalibard dire cette ballade dont j'ai sous les yeux le manuscrit?:
Belle princesse émeraudine,
Viatique du malheureux,
Merci ! Toi qui fais que je dîne
Royalement d'une sardine...
Absinthe ! morphine des gueux !
Adolphe Gensse lui-même, le spirituel et joyeux Gensse, a sacrifié à la mode et chanté le poison qui console?:
Absinthe, enlève-nous vers des mondes nouveaux.
Sois la Muse terrible affolant nos cerveaux ;
Réveille tous nos sens pour nos dernières fêtes,
Et mets des flamboiements d'étoiles sur nos têtes !
Qu'on se rassure, les poètes du Procope ne buvaient pas toujours plus que de raison. Leurs chansons bachiques ne manquent pas, sans doute, de sincérité ; mais il s'y mêlait bien un peu de littérature.
XI.
Quelques-uns du Procope ? Théo Bellefonds ? Laurent Tailhade ? Monsieur Parfait ? Alfred Poussin
Parmi les habitués du Procope en 1895, il en était dont l'étrange silhouette et le bizarre accoutrement donnaient au vieux café une physionomie bien curieuse.
Théo le patron n'était pas le type le moins amusant.
 < <
Georges Montorgueil a, dans l'éclair, tracé du troquet-artiste cet exact portrait : "Les caricaturistes se plaisaient à le représenter, vêtu comme Balzac, à qui il ressemblait, par la corpulence et l'ampleur du front, dans une large robe de moine [suggéraient une certaine parenté] avec les anciens bénédictins. Mais son parler lent, l'onction de sa parole, sa délectation à aborder des sujets d'érudition [faisaient de lui] un bénédictin de belle humeur, indulgent à la jeunesse, curieux du talent en herbe. - Mécène? Il n'avait pas les moyens de l'être ; il lui fallait payer sa capita[lisa]tion et ses fournisseurs. Il ne pouvait verser à flots dans les bocks une bière gratuite ; mais on avait, chez lui, cette latitude de longuement fl?ner, sous couleur de consommer une absinthe qu'on pouvait négliger de se faire servir."

Théo laissait à sa femme et à sa belle-sœur, l'aimable Mlle Julie, le soin de s'occuper de la "limonade". Il avait de plus graves préoccupations, et demeurait pendant la plus grande partie de la journée enfermé dans un réduit sans air, situé au fond du café, et qu'il appelait son atelier, c'est là, qu'amoureusement, il classait ses documents et griffonnait ses notes, au milieu d'une poussière grasse et malodorante.
Ce patron de café aurait été bien vexé si on l'e?t traité de cafetier. Le Procope était pour lui un salon, et il entendait que les clients s'y conduisissent comme des invités de bonne compagnie. Quelque consommateur se permettait-il de faire une observation, Théo s'avan?ait doucement, et avec une politesse affectée, faisait remarquer au malotru qu'il était "chez Procope" et qu'il devait s'y tenir "honnêtement". Est-il besoin de dire que le client ainsi gourmandé s'en allait furieux et ne revenait plus !

Je n'ai pas eu l'occasion de voir souvent Verlaine au Procope. Au moment où je devins un familier de la maison, le pauvre poète n'y faisait plus que de rares apparitions entre deux séjours à l'hôpital ; mais j'ai bien connu un autre grand méconnu, et découvert le vrai caractère de celui que les mufles qu'il a cravachés se sont appliqués à nous dépeindre égo?ste et cruel..
Dans un émouvant article sur Laurent Tailhade, Georges de la Fouchardière a naguère, dans l'Œuvre, fait justice de ses calomnies. Tailhade était un sensible. Mais, écrit La Fouchardière : "Il avait peur de se montrer bon", et toute sa vie, "il s'est donné beaucoup de mal pour paraître méchant".

Pour ma part, je l'ai toujours trouvé attentif à nos efforts et indulgent à nos petite rosseries.
Un jour qu'il terminait en h?te un article, dans le petit salon, sur la table de Voltaire, un gros rat sorti de l'atelier de Théo vint rôder autour de lui et le mordit cruellement au talon.
Quelqu'un raconta l'histoire le lendemain, dans un méchant petit écho : "M. Tailhade va mieux, ajoutait-il, mais le rat est mort !" Tailhade sut bientôt qui était l'auteur de cette gaminerie. "C'est vous, dit-il à l'échotier, de ce ton à la fois courtois et ironique qui était sa manière ; c'est vous, j'en suis s?r, qui avez imaginé cette fine plaisanterie. J'ai tout de suite reconnu la couleur de votre esprit."
Ce fut là toute sa vengeance.

Le client le plus chic du Procope, celui pour qui la caissière et les gar?ons avaient la plus grande admiration, était M. Parfait Berthelot, un vieux Monsieur d'un "incertain ?ge", dont l'élégance contrastait singulièrement avec la mise négligée de l'ordinaire clientèle.
Perruqué, pommadé, cravaté avec art, et chaussé de fine soie dans d'impeccables "vernis", M. Parfait, le bien nommé ! s'effor?ait à réparer des ans l'irréparable outrage. Et, sur ma foi, il y réussissait assez bien.
Personne ne se f?t avisé de donner à ce vieux beau les soixante-quinze ans qu'il portait si allègrement ; personne, hormis Théo, qui pendant longtemps avait été son voisin, alors qu'il habitait rue Saint-André-des-Arts.
Monsieur Parfait, professeur de droit, avait été le répétiteur de Paul Deschanel, et la vérité m'oblige à dire qu'il ne se montrait pas très fier de son élève.
Quand celui-ci fut élu Député, nous cr?mes devoir lui annoncer la bonne nouvelle. M. Parfait resta un instant silencieux : "Pauvre petit Paul, murmura-t-il enfin, je n'en ai jamais rien pu tirer !... Député ! c'était tout ce qu'il était bon à faire."
Simple boutade d'un vieux maître qui n'avait pas su, dans son disciple, pressentir le politicien.
Parisien né, M. Parfait, pour un empire, n'e?t consenti à quitter Paris. Il avait horreur de la campagne et des campagnards. "Ce sont les paysans qui nous apportent les microbes, disait-il. Paris serait la ville la plus saine du monde si on n'y laissait entrer ces provinciaux."
Quand je devais m'absenter pour aller passer quelques jours dans ma Vendée natale, l'excellent homme s'inquiétait, se tourmentait. "Vous allez aux champs, mon pauvre ami ! Prenez garde que vous n'y tombiez malade ! l'air à la campagne est si mauvais !" Et il me serrait les mains avec émotion.
Monsieur Parfait était un ami d'Edouard Pailleron. Il dînait chez lui chaque semaine. Quand celui-ci mourut, M. Parfait parut profondément affecté. "Vous voyez, me dit-il, Pailleron se portait très bien. Il occupait, dans le centre, un appartement très sain, dans une rue bien propre. Un jour, il a eu l'idée saugrenue d'aller habiter sur les quais. Devant ses fenêtres, il y avait de l'eau, de l'herbe, des arbres... Et bien, il est mort !"

J'ai connu au Procope bien des originaux : le peintre A. Drien, qui fabriquait des marines en chambre. en figurant, sur son bureau, les rochers avec des morceaux de charbon, et les voiles des bateaux avec un mouchoir de poche tendu sur deux porte-plume ; le poète Camille Girault, qui dès qu'il avait bu un apéritif, se livrait à mille excentricités ; la pauvre Ratata, "reine des poètes", et le délicieux père Maron, qui prétendait descendre directement de Virgile ! Mais aucun, parmi ces types falots, ne m'amusa autant que le poète Alfred Poussin, le plus fidèle, sinon le plus intéressant client de la maison.
Laurent Tailhade, dans l'important article qu'il consacra à ceux du Procope, et qui parut dans le Voltaire, n'eut garde, d'oublier ce vieux bohème "grand, maigre, efflanqué, pochard et bénisseur", qui "trouva le moyen de vivre pendant soixante ans et plus de son génie".
L'&œlig;uvre de Poussin tient tout entier dans un petit volume : Versiculets, préfacé par Alfred Vallette, petits poèmes écrits au jour le jour, et dont quelques-uns contiennent d'amusantes réflexions, voire des vers heureusement venus.
Il est de Poussin ce quatrain que Jean Richepin citait un jour dans la Revue de France, sans nommer l'auteur?:
J'ai vécu longtemps au hasard,
Sans un sou, bayant à la nue,
Ne pouvant entrer nulle part,
J'étais prisonnier dans la rue.
Et j'ai retrouvé, dans mes papiers, le manuscrit autographe de ces petits vers à Sir Richard Wallace, parus ci première page du Journal parlé, accompagné d'un amusant dessin de E Vibert.
Sir, votre coupe est pleine
Du vin d'un bon tonneau.
Moi, qui n'ai pas de veine,
Je ne bois que de l'eau
Et rien autre...
A la vôtre !
J'en ai bu plus d'un seau,
Cet hiver, sous les fesses
De vos quatre Déesses ;
Grelottant dans ma peau,
Et rien autre...
A la vôtre !
Le poème se composait de quatre strophes: c'est, avec La Jument morte, une des pièces les plus longues écrites par l'auteur des Versiculets.
Gustave Le Rouge, dans les souvenirs qu'il publia naguère, dans les Nouvelles littéraires, sous ce titre : Verlainiens et Décadents, a conté la mésaventure que valut à Fran?ois Coppée sa ressemblance avec Alfred Poussin.
Des marchands de chevaux qui, apparemment, étaient aussi des amateurs de poésie, apercevant Poussin au Café d'Alen?on, voisin de la gare Montparnasse, crurent reconnaître l'auteur des Intimités, et le prièrent de leur faire l'honneur de trinquer avec eux. Poussin accepta de bonne gr?ce. Il trinqua même tant et tant qu'il rentra chez lui complètement ivre. La semaine suivante, nos maquignons attablés dans le même établissement, s'enquirent de leur ami le poète. "Monsieur Coppée ? dit le gérant, il vient ici tous les jours. Tenez, il est justement là." Fran?ois Coppée, c'était lui, cette fois, essaya de dissiper le malentendu ; mais les autres ne voulurent rien entendre
"De quoi ? s'écrièrent-ils, tu ne nous reconnais pas ? C'est toi qui a bu avec nous l'autre soir ? même que tu nous as récité La Jument morte, une pièce de vers que tous les marchands de chevaux devraient savoir par c&œlig;ur... Et bien, t'en as un culot !..."
Le pauvre Coppée dut renoncer à leur faire entendre raison, et finalement s'enfuit sous les quolibets et les injures des maquignons indignés.
Les histoires abondent, dont Poussin fut le héros.

Un jour, ses amis du Procope décidèrent de lui jouer un bon tour. Ils fabriquèrent une lettre qu'ils signèrent du nom de A. Poussin, et l'adressèrent à Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l'Académie Fran?aise. Dans celle-ci, Poussin rappelait qu'il était l'auteur des Versiculets qui, disait-il, avaient eu 28 éditions, et il faisait savoir à Camille Doucet qu'il posait sa candidature au fauteuil de Leconte de l'Isle, qui venait de mourir.
Notre bohème ne fut pas peu surpris de recevoir le lendemain, au café, un pli portant cette suscription : Académie Fran?aise, Secrétariat. Il l'ouvrit en maugréant : "Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens-là ? Je m'en fous, moi, de leur Académie !"
Pourtant en parcourant la lettre, il écarquilla les yeux : Camille Doucet le priait de prendre la peine de passer le plus tôt possible au Secrétariat, pour "affaire le concernant..."
Les mystificateurs eux-mêmes n'en revenaient pas ! La convocation portait le cachet de l'Académie et le Secrétaire y avait apposé sa signature.
"Non, je n'irai pas, répétait Poussin, je me moque des honneurs..."
"Va toujours voir ce que l'on te veut", conseillaient les amis intrigués.
Le soir, ils eurent le mot de l'énigme. M. Parfait avait, la veille, rencontré dans un salon Camille Doucet. "Comme on connaît mal les poètes modernes ! lui avait dit celui-ci au hasard d'une conversation. Je re?ois chaque jour des lettres de gens qui m'apprennent qu'ils ont écrit des ouvrages parfois intéressants. Ce matin encore, j'ai trouvé dans mon courrier un mot tout à fait touchant d'un vieux poète qui est l'auteur d'un petit volume dont le succès est, paraît-il, considérable on en a fait vingt-huit éditions ! Et bien ! je l'avoue, j'ignorais son nom ! Il s'appelle Alfred Poussin."
"Poussin ! mais je le connais très bien, s'écria l'excellent M. Parfait, c'est un client du Procope, un vieux brave homme qui vit en bohème, et mériterait certes d'être secouru. Puisque l'Académie dispose d'un certain nombre de prix, pourquoi ne lui eu donneriez-vous pas un ? Cela flatterait son amour-propre et garnirait un peu sa bourse..."
"Affaire entendue ! avait répondu C. Doucet. Je vais, dès demain, convoquer votre protégé, et je lui ferai remettre une petite somme de cinq cents francs."
Conseillé par M. Parfait, Poussin se décida à se présenter au Secrétariat de l'Académie avec ses Versiculets ornés d'une flatteuse dédicace. Il toucha les cinq cents francs. Cinq beaux billets ! Une fortune pour le pauvre homme. Il les mangea immédiatement. Je veux dire qu'il les but ! Il ne dessaoula pas pendant quinze jours, et se montra durant cette ère de richesse d'une insolence toute particulière à l'égard de ses camarades du Procope qu'il ne soup?onna jamais d'avoir été ses bienfaiteurs !

J'ai nommé, dans le précédent chapitre, les écrivains et les artistes qui fréquentaient le vieux café de la rue de l'Ancienne-Comédie, au temps où j'étais moi-même le client sérieux. Bien d'autres s'attardèrent au Procope à cette époque, dont plusieurs connaissaient la célébrité. Je me souviens d'y avoir vu Oscar Wilde "engraissé et repenti" ; Adolphe Retté qui déjà songeait à se convertir au catholicisme et préparait son livre du Diable à Dieu ; Emile Boissier, le beau poète du Chemin de l'irréel ; Han Ryner, qui signait alors, tout simplement, Henri Ner ; Gabriel Vicaire et Henri Beauclair, les spirituels auteurs des Déliquescences d'Adoré Floupette ; Frédéric Boutet, dont l'étonnement devant l'indifférence d'une jeune Procopéenne se manifesta par l'édition d'une plaquette : Vierge et martyre, qui fut, je crois, son premier livre.
D'autres encore - jeunes hommes de lettres et écrivains notoires - passèrent au Procope aux environs de 1895 : Charles Cros, Edouard Pailleron, Pierre Louys, Anatole France, Jean Aicard, Jean Richepin, Adolphe Brisson, Marc Legrand, Louis le Cardonnel, Paul Brulat, Charles Le Goffic, Paul Souchon, Léon Parsons, Martine, Charles Charpentier, les sculpteurs Henri Bouillon, Ernest Jetot, etc.
C'est au Procope que j'ai, pour la première fois, rencontré ces confrères aimables dont je suis devenu l'ami : les poètes Jacques Dyssord, Raphaël Larquier, Tristan Klingsor ; les journalistes Georges de La Fouchardière, C.-M. Savarit, Edouard Dulac, J. Valmy-Raysse, aujourd'hui secrétaire de l'Académie Fran?aise ; Alcanter de Brahm, l'inventeur du point d'ironie ; Marius Boisson et Armory, que je devais retrouver vingt ans plus tard à Com&œlig;dia, et Maurice Boukay, en politique Charles Couyba, l'auteur des Stances à Manon, chansonnier glorieux et ministre sans gloire.
Des artistes se mêlaient aux écrivains, comme au temps où les compagnons de Molière étaient installés dans l'immeuble qui fait face au Procope : Irma Perrot, Louise France, Violette Dechaume, Rachel de Ruy, Barbarini, C&œlig;lia Grienty, Christiane Mendelys, Maxence Perrin, Georges Wague, etc.
Eugénie Buffet a rappelé dans ses Confidences, recueillies par Maurice Hamel, qu'elle dut un jour, réclamée par la foule massée dans la rue, paraître au balcon du café Procope et y chanter la Sérénade du pavé. C'était au temps où Stevens, Cazals et moi, nous suivions Nini Buffet dans les rues de Paris, et chantions avec elle, cette fameuse chanson de Jean Varney, dont les paroles étaient aussi pauvres que ceux pour qui nous faisions la quête
Sois bonne, ô ma chère inconnue,
Pour qui j'ai si souvent chanté...
XII.
Les dîners de la Rive Gauche ? Le Gringoire ? La pléiade ? Les soirées-procope (1893-1900)
Tandis qu'au rez-de-chaussée, les vieux jouaient aux dominos ou "poussaient le bois" en fumant la pipe, dans la salle de spectacle aménagée au premier étage, les jeunes poètes chantaient ou disaient des vers, renouant ainsi une aimable tradition..
Des réunions d'écrivains avaient eu lieu, en effet, au Procope, aussitôt après la guerre de 1870.
Ce fut une espèce de Bon Bock du Quartier Latin.
J'ai sous les yeux plusieurs invitations à ces Dîners, curieusement illustrées et accompagnées de poèmes de circonstances.
Le premier eut lieu en novembre 1876, sous la présidence de Gustave Aymard. Je relève parmi les noms des invités, ceux de Victor Adam, E. Bellot, Alexis Bouvier, Etienne Carjat, Charpentier, Léon Cladel, Adrien Dézamy, Henri Second, José Frappa.

Les premières soirées auxquelles le public fut convié, s'intitulèrent Soirées du Gringoire et furent organisées en 1893, au lendemain de la réouverture du Procope, par le chansonnier Pierre Trimouillat, qui appartenait alors à la troupe du Chat Noir.

L'illustre compagnie venait de quitter la rue Victor-Massé pour faire en province une longue tournée, et Trimouillat, contraint de demeurer à Paris où le retenaient ses fonctions de bureaucrate, avait eu l'idée de proposer au patron du Procope d'installer au premier étage un Cabaret artistique, à l'instar de Montmartre. Les premiers programmes portent les noms de Paul Delmet, Eugène Lemercier, Vincent Hyspa, Lautrec, Yan Nibor, Marcel Legay, etc.
Les chansonniers du Gringoire voulurent, eux aussi, avoir leur journal. Paul Hervieu, Curnonsky, Armand Masson y collaborèrent.
"Les rédacteurs, déclarait un curieux communiqué paru dans le journal Le Procope, se proposent de se faire comprendre de leurs lecteurs. à l'encontre des Symbolistes où ne vont pas leurs sympathies, et des Décadents pour lesquels ils ne manifestent
aucun go?t, ils s'efforceront de parler la langue qu'on a parlée jusqu'ici en France."
Les chansonniers du Gringoire ne devaient pas s'attarder longtemps au Procope. Montmartre les attirait. Seul, Trimouillat demeura au Quartier Latin et bientôt, avec le concours de Gaston Dumestre et de Xavier Privas qui venait de se faire connaître aux soirées de la Plume, il réorganisa les spectacles interrompus qui prirent le nom de Soirées-Procope.
Les temps étaient durs, alors, aux chansonniers qui ne connaissaient pas l'art de faire à leur talent l'indispensable publicité.
Théo, d'ailleurs, n'e?t point consenti à couvrir les murs de tapageuses réclames pour informer les bourgeois du Quartier qu'il tenait chez lui boutique d'esprit et de gaieté.
Un simple placard manuscrit collé sur un des panneaux de la devanture, apprenait au passant que les Soirées Procope avaient lieu au premier étage et qu'on y entendait, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, les bons chansonniers de l'endroit dans leurs &œlig;uvres.
J'errais un soir, dans la rue de l'Ancienne-Comédie, quand mon regard se porta sur la petite affiche. J'hésitai, intimidé un peu par les larges feutres et les lavallières des habitués ; puis, je me décidai à pousser la porte.
On accédait au premier étage par un petit escalier en tire-bouchon que faisaient plus étroit encore les croquis et les tableaux accrochés au mur. Après avoir traversé une antichambre qui servait de vestiaire, on pénétrait dans une salle au plafond élevé où quatre-vingts chaises alignées en rangs serrés représentaient les fauteuils d'orchestre et le parterre.
Au fond, un tréteau large d'un mètre cinquante était dressé. C'était le plateau.
J'ai conservé de cette soirée un souvenir très précis. Les fantaisies rimées de Trimouillat me parurent infiniment spirituelles, et j'écoutai avec une attention recueillie les poèmes qu'en zézayant quelque peu, disait Georges Wague. J'ai compris depuis pourquoi celui-ci, aujourd'hui premier mime à l'Opéra et professeur au Conservatoire, avait remplacé la parole par le geste... J'entendis aussi, ce jour-là, Turbert et un autre chansonnier assez terne dont j'ai oublié le nom.
Celui qui le plus m'émerveilla, ce fut Xavier Privas. Il chantait d'une voix généreuse, en s'accompagnant au piano, des strophes qui me semblaient écrites dans la plus pure forme classique. J'admirai qu'on p?t, dans une chanson, réunir tant de symboles et accumuler tant d'effets littéraires?:
Pour reposer tes sens, j'ai conjuré Morphée
D'auréoler ton corps d'anéantissement,
Et j'ai prié ta s&œlig;ur, la souveraine fée,
De parer tes esprits du nimbe "enchantement"...
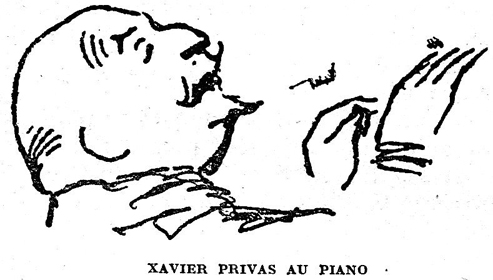
Je sais aujourd'hui que l'art difficile du chansonnier est précisément d'éviter les artifices de rhétorique et d'exprimer avec les mots les plus simples, les plus fortes pensées.
La soirée se terminait par la représentation des Cantomimes, de Privas, chansons que mimaient Georges Wague et la mignonne Christiane Mendelys, tandis qu'elles étaient chantées par l'auteur dans la coulisse.

Il me souvient d'avoir, ce jour-là, entendu Le Testament
de Pierrot et La Noël de Pierrot qui sont, avec Le Coffret, La Chanson des Heures et La Chanson d'Adieu, les ceuvres
les meilleures et sans doute les plus durables de X. Privas, parce que les plus simplement et les moins littérairement écrites.
Adolphe Brisson, dans un article paru dans le Temps et que le lecteur retrouvera dans ses Voyages à travers Paris, a fait à cette époque un amusant compte rendu des Soirées-Procope et conté comment il y découvrit Verlaine, s'étonna de l'honnête candeur de Xavier Privas et s'amusa de la voix fl?t
Représentez-vous, écrit-il, un salon étroit et profond, coupé en deux parties par un rideau. D'un côté les auditeurs, de l'autre l'inévitable piano et les artistes... Ils défilent en bon ordre. Ils sont trois qui se succèdent et font le roulement. D'abord, l'ineffable Trimouillat. Vous connaissez Clovis Hugues ! Prenez Clovis Hugues par la tête et par les pieds, et tirer de fa?on à l'allonger de 50 cm. Vous avez Trimouillat. C'est un Clovis aminci, vacillant sur de longues jambes maigres. Et la voix, comme le corps, a diminué. La voix de Clovis est un tonnerre marseillais; c'est le Mistral qui souffle au pont d'Avignon; c'est le Rhône, aux flots tumultueux; la voix de Trimouillat est une caresse de jeune fille. Et Trimouillat nous dit, envers harmonieux, la puissance corruptrice de l'argent et la déplorable immoralité des classes capitalistes. Trimouillat disparaît!Il est remplacé par Xavier Privas, honnête chansonnier qui croit encore à l'amour, au printemps en fleurs, aux papillons et aux roses. Comme il achève son troisième papillon, la porte s'ouvre et nous le voyons paraître. Il s'appuie sur une canne et traîne la jambe. Il est vêtu d'un paletot-sac, coiffé d'un chapeau mou; sa face est luisante, son front est bossué, comme un vieux chaudron de cuivre; sa barbe, rebelle aux efforts du peigne, forme un inextricable tissu. Il est suivi d'un disciple, le dessinateur Cazals, qui s'attache à ses pas, exalte sa gloire et crayonne son portrait, de face, de dos, de profil, par le flanc droit et par le flanc gauche. Et n'écoutant plus la musique, insensible aux accents de Trimouillat, je contemple ce vieillard qui jouot [jouissait ?] à Paris d'une si prodigieuse réputation, Paul Verlaine (car c'est lui et vous l'aviez deviné!)... vient ainsi entre deux villégiatures à l'hospice Broussais, se délasser au Procope ou dans quelques autres "beuverie" du Quartier Latin. Trimouillat le console de Broussais, Broussaos le repose de Trimouillat. Il s'achemine de la sorte, cahin-caha vers le repos éternel. Et pour lui rendre la route plus agréable, ses amis les étudiants assemblés en concile, le proclament successeur de Musset, poète de la Jeunesse fran?aise. Oui, ce podagre, ce rhumatisant, ce malade de brasserie et ce pilier d'hôpital incarne en ses haillons, sur sa face jaunie, en ses mains tremblantes, l'?me de la jeunesse fran?aise !
J'ai vu l'?me de la jeunesse fran?aise boire un bock et se moucher dans un mouchoir à carreaux.:. Je n'ai point perdu ma soirée et je n'ai pas lieu de regretter ce petit voyage au Pays Latin...
C'est de cette irrévérencieuse fa?on que le critique du Temps présentait à ses lecteurs, le poète des Fêtes galantes et le chansonnier qui devait, un .jour, être élu Prince par ses pairs.

Cependant les Soirées-Procope étaient lancées, classées. C'est sur la petite scène de la rue de l'Ancienne-Comédie que furent jouées pour la première fois telles saynètes de Courteline qui devaient être reprises au Cabaret du Carillon, rue de la Tour d'Auvergne, avant d'être inscrites au répertoire de thé?tres plus importants. Enfin, c'est au Procope qu'eut lieu en 1894, la première représentation de Madame Aubin, l'acte de Paul Verlaine, au cours d'une soirée de gala donnée au bénéfice du poète.
Le clou fut une étincelante conférence de Laurent Tailhade dont je retrouve le compte rendu dans le journal Le Procope :
La représentation, note le chroniqueur, rapporta au bénéficiaire un nombre respectable ,de billets de cent francs, alors qu'une matinée organisée au Vaudeville, au bénéfice du Maître, avait produit "peau. de balle".
Cette soirée mémorable devait être une des dernières données par la petite troupe.
Le premier numéro du Procope de l'année 1895 annonce mélancoliquement le départ des "bons camarades" en même temps qu'il apprend au public la résurrection des réunions?:
"Le Roi est mort ! Vive le Roi !" - Les Soirées-Procope renouvellent ! Voici venir, avec l'an neuf, la Pléiade, groupe de jeunes poètes qui, de la Plume au Procope, va semant le bon grain de la bonne chanson. Dimanches et jeudis soirs, les salons du café tiendront cour de Jeux Floraux où tout artiste ès-rimes et beaux dires est invité à se faire entendre".
Les réunions de la Pléiade étaient organisées par le chansonnier F.-A. Cazals. Elles ne devaient durer que quelques soirs !

Un jour que, venu seul au Procope, je devisais avec le patron et lui confiais mon regret de ne plus pouvoir entendre les chansonniers de la maison, Théo me dit à br?le-pourpoint :
- Eh bien ! vous qui êtes jeune et qui avez de nombreux amis, pourquoi ne remplaceriez-vous pas ici vos aînés ?
L'offre était tentante. J'avais vingt-trois ans. J'acceptai, sans songer à demander la moindre rémunération.
Théo vit tout de suite que je n'étais pas un avisé commer?ant ; mais il ne voulut point abuser de ma candeur. Il fut convenu qu'un large crédit me serait ouvert. Entendez que le patron s'engageait à me faire, chaque soir, l'avance d'un dîner, à la condition que je prisse, de mon côté, l'engagement de payer plus tard la petite note.
Huit jours après, de superbes cartes gaufrées par Théo et qui représentaient une femme nue à genoux devant un grand livre (le livre de l'Histoire, sans doute!) annon?aient l'ouverture des nouvelles Soirées-Procope.
Je souris aujourd'hui au souvenir de ces soirées fameuses.
Le décor était resté le même. Le rideau était d'andrinople, la toile de fond d'andrinople et d'andrinople aussi les frises et les portraits. Bien avant nos modernes directeurs, nous avions simplifié la mise en scène et réduit le nombre des accessoires. L'action se passait-elle dans une un intérieur ? Un tableau chipé dans l'escalier et accroché sur le fond (pardon, sur l'andrinople) indiquait clairement que l'on était dans un salon. S'agissait-il de figurer en plein air ? Deux plantes vertes empruntées à la caissière du café suffisait à donner l'illusion d'un jardin merveilleux... Edmond Roze n'eut pas fait mieux!
Bien entendu, nous ne pouvions songer à établir par avance un programme et nous ne savions, en frappant les trois coups, si nous pourrions tenir jusqu'à minuit. Je devais m'en remettre au hasard, qui parfois d'ailleurs faisait fort bien les choses. Il y eut au Procope, gr?ce à des concours inattendus, de brillants spectacles, que n'aurait pas pu présenter le plus fastueux directeur, ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus parus dans la Plume à cette époque.
Laurent Tailhade écrivait de son côté dans le Voltaire?: "Bureau d'esprit enté sur un débit de spiritueux. Le Café Procope est sans doute le plus intéressant parmi tant de cabarets intellectuels."
Je revois le défilé sur la petite scène, des chansonniers rosses et sentimentaux : le long est cocasse, Adolphe Gensse, le bon gros Dollinet, le maigrillot [maigriot ?] érasme, l'indolent Escourrou, Louis Hébert et son monocle, Paul Weil et sa barbiche et le bon barde barbu Guynetto de son vrai Guyonnet qui, en. s'accompagnant à la mandoline, hantait de curieuses chansons vendéenne, recueillies et harmonisées par lui.
J'entends encore les poètes Henri Degros, Paul Leclère, Jacques Le Guillin, Camille Giraud, Gustave Le Rouge, Gustave Guiton, Pierre Mestro et je me revois moi-même, la taille serrée dans une romantique redingote à godet, et chantant d'une voix frêle - comme il convenait - ces Frêles Chansons dont j'avais écrit les paroles et la mélodie.
Serait-ce l'influence du décor, le souvenir des belles inhumaines qui, jadis, avaient promené là leurs sourires et leurs dédains. Les poètes du Procope se plaisaient à rimer des sonnets et des madrigaux. Je ne pouvais manquer de céder à cette manie de marivauder et je disais volontiers, entre deux chansons, ces petits verres impertinents que j'intitulais La bonne excuse :
Quoi, vous me boudez à présent Madame.
Courroux bien tardif ! Regrets superflus !
Vous m'aviez permis un baiser, et dame.
J'ai cru sur mon ?me.
Devoir un peu de plus...
Et si celui-là, chère marquisette,
S'arrêta plus loin qu'il aurait fallu.
C'est qu'un peu troublé, sous la chemisette,
Près d'un fossette,
Il s'était perdu...
Un mignon baiser vaut-il qu'on s'irrite ?
Il fut, le pauvret, bien doux... au surplus
Si vous en avez l'?me si contrite,
Rendez le moi vite,
Et n'en parlons plus !...


Les humoristes du Procope ne perdaient pas leur temps à railler les politiciens en place et les vedettes fatiguées. C'est contre les arrivés de la littérature qu'ils dirigeaient leurs traits acérés. Quand ils étaient las de blaguer les autres, ils s'égratignaient entre eux, comme dans cette Ballade des Chansonniers du malicieux Gensse?:
Quand les chansonniers vont par deux,
Ils se félicitent entre eux?:
"Ton dernier... machin est très bien.
As-tu vu l' mien ?
Il r'ssemble au tien;
Il est plus ross', mais plus ancien."
André Joyeux était plus méchant, lorsqu'il chantait ces couplets que l'on croirait écrits à l'adresse de certains Montmartrois d'aujourd'hui?:
Avec la froideur d'un gla?on,
Quand ils débitent leur chanson,
Ils ont de petits airs féroces,
Insolents et provocateurs,
Qui font trembler les spectateurs?:
Ce sont les bons chansonniers rosses!
Tout en raillant les cabotins,
Ils posent plus que des catins
Convolant en très justes noces ;
Si délicat est leur esprit
Qu'il n'est que par eux, bien compris?:
Ce sont les bons chansonniers rosses !
Moi, j'en voulais surtout à tels littérateurs qui jugeaient sans indulgence nos couplets et qui croyaient être de vrais poètes parce qu'ils s'appliquaient à rimer richement, et je les raillais sur l'air de Ma Gigolette en des couplets aux rimes millionnaires?:
On n'croirait jamais qu'sur la terre,
Y en ait tant et tant ;
Et voilà bien ce qui m'atterre,
C'que j'trouve inquiétant !
Calicot ou clerc de notaire
,
Pour en faire autant,
N'ont qu'à s' rendr' chez l'dépositaire
Du p'tit excitant.
Tout en prenant une bonne biture,
On aligne à tir' larigo
Quat' vers sur l'Savon du Congo,
On s'arrange pour qu' ?a rime en ture ;
?a y est, c'est d' la littérature !
Malheureus'ment, j'dois pas vous 1'taire,
O ! jeun' débutant,
Dans c' métier, faut un caractère...
Rud'ment résistant ;
Chacun contre vous, déblatère,
C'est déconcertant !
C'est seul'ment quand on vous enterre,
Qu'on d'vient épatant !
J' conseille à vot' progéniture
D' s'installer épicier en gros ;
Ami qui rêvez de gagner gros,
Au lieu d' fair' d' la littérature,
Que n' vendez-vous d' la confiture !
Caché derrière son piano, le compositeur Léon Heckmann, qui s'appelait alors Alcib. Mario, accompagnait flegmatiquement les chansonniers à voix et les autres, et profitait du repos que lui accordaient les diseurs et les poètes pour les blaguer en petits vers qui ne manquaient ni d'esprit ni de malice?:
- Gentleman chic, parfait dandy,
L'exquis poète Millandy,
Sur une tonalité grêle,
Débite le sucre candi
Des vers jolis qu'il fit pour Elle.
Je veux croire que "sucre candi" n'était là que pour les besoins de la rime ; mais je n'en suis pas très s?r...

On ne se contentait pas, au Procope, de dire des vers et de chanter des chansons ; on s'y livrait à d'autres jeux moins innocents. Des pièces y furent jouées qui tinrent l'affiche pendant de nombreux soirs : L'Habit de velours, comédie en trois tableaux de Th. Bellefonds, qui mettait en scène Piron, Collé et Gallet, le poète-épicier ; Messire Duguesclin, d'Ad. Gensse, farce énorme à la manière d'Henri de Bornier, et le Rêve de Théo de Jules Moulin, dont j'avais écrit le prologue en alexandrins, s'il vous plaît!
Celui-ci n'avait pas moins de quatre-vingts vers. Je vous fais gr?ce de la première scène ; mais je ne résiste pas à l'envie de citer l'autre.
Théo, après avoir vu en songe, apparaître Procopio, re?oit à son lever, la visite du "Jeune Auteur".
(La rampe s'éclaire. L'orchestre attaque : Manon, voici le soleil.)
THÉO
J'ai dormi, cette nuit, aussi bien qu'un critique
En son fauteuil. (On frappe.)
Entrez... C'est quelque domestique.
Entre Le Jeune, et ce dialogue s'engage?:
- Bonjour, monsieur Théo, comment vous portez-vous ?
-
Mais, comme vous voyez, ?a n' va pas mal, et vous ?
Excusez-moi : le temps de mettre mes chaussettes !
- Peste, monsieur Théo, quel bel homme vous êtes !
-
Vous croyez ?
-
J'en suis s?r : le port majestueux,
L'air noble, le front haut et le geste onctueux !
Sous les cils clignotants, l'œil malin qui flammèche,
L'occiput d'un penseur dessous le casque-mèche.
Sur ma foi, vous feriez un Salis peu banal,
Et nous aurions en vous mieux que l'original.
Je le veux ! Que chacun se rende à l'évidence,
Théo, Théo le grand, devient la Providence
Des jeunes méconnus...
-
Vraiment, c'est trop d'honneur !
-
Je suis venu, monsieur, faire votre bonheur.
- Vous êtes... cher monsieur ?...
-
Quelque chose de vague,
Mais n'allez point penser, pourtant, que je divague ;
Je suis tout à la fois et ceci, puis cela,
Et tous, et chacun d'eux, et moi-même, et ceux-là ;
Car je suis, en effet, tous ceux qu'il faut connaître,
Que ne sait point Sarcey, et qu'ignore Lemaître ;
Je représente, enfin, tous ceux de ce temps-ci !
De ce temps ? Et qui donc ? Yon-Lug ? Bruant ? Fursy ?
Ah ! là-bas, à Montmartre ? Oh ! c'est bien loin !
-
Sans doute,
Ils sont ici des tas, monsieur, sans qu'on s'en doute ;
Poètes novateurs, de Montmartre incompris,
Chansonniers verveux, combien subtils d'esprits !
Plus forts, cent mille fois, que tous ceux qu'on acclame ;
Je citerais des noms, si j'aimais la réclame.
-
Vous m'intéressez fort ; mais pourrais-je savoir, Monsieur, au nom de qui vous m'êtes venu voir ?
-
Au nom de tous, monsieur ; toute la gent de lettre,
Rêvant de jours meilleurs, hier, me fit promettre
De venir demander ton aide ; j'ai promis !
Et maintenant, Théo, me sera-t-il permis
Pour chacun d'eux, de te tendre une main amie ?
(Ils se serrent la main avec effusion.)
Théo ! Tu en seras !
- De ?
- De l'Académie !
La pièce de Jules Moulin avait de réelles qualités ; mais le grand succès, il me faut le dire, ma modestie d?t-elle en souffrir ! était pour une œuvre moins importante et écrite en vers plus faciles : L'Affaire
de Nayve.
J'avais eu l'idée de présenter au public des chansons illustrées, en m'inspirant d'une formule depuis longtemps utilisée par les bateleurs forains. L'affaire de Nayve, crime mondain, disaient les journaux, devait me fournir l'occasion de faire une expérience qui fut couronnée d'un complet succès.
M'improvisant dessinateur et peintre, j'avais rappelé en une douzaine de tableaux grossièrement barbouillés sur un large calicot, les principaux épisodes de l'affaire.
La toile était lentement déroulée pendant un trémolo impressionnant et, tandis que je chantais sur l'air Le Pou et l'Araignée une complainte émouvante à souhait, j'indiquais à l'aide d'une baguette les diverses scènes peinturlurées, depuis l'idylle au jardin jusqu'au jugement de l'accusé que l'on voyait à la cour d'assises, verdi par la peur, devant les robes écarlates des juges...
L'effet, chaque soir, était irrésistible, et L'Affaire de Nayve n'eut pas moins de cent représentations.
Nous mont?mes sur la petite scène du Procope bien d'autres spectacles. Des séances de musique ancienne y furent données, sous la direction du compositeur Alcib. Mario, et des conférences accompagnées d'auditions y furent faites par Laurent Tailhade, Achille Segard, Fernand Hauser, René de la Villoyo, Xavier Privas, Louis Hébert, etc. On y entendit même, dans ses improvisations musicales, Mérovak, l' "Homme des Cathédrales", qui trouvait en ce temps-là, le moyen d'intéresser toute la presse à ses excentricités et à ses fumisteries.
XIII.
Devant le buste de Benserade - Le dernier soir du "Procope"
Un Gentillien - lisez un habitant de Gentilly -
M. A. Grippa de Winter, homme aimable et lettré,
forma un jour le projet de faire élever par les soins
de la municipalité un buste à Benserade qui, pen-dant quelques années, avait vécu sur les bords de
la Bièvre, et it eut l'idée de demander aux chansonniers du Procope de corser le programme de la cérémonie en donnant dans la salle de l'école commu-
nale, mise à sa disposition, un concert au cours duquel l'auteur du Sonnet de Job devait etre glorifié
comme it convenait.
Ce fut une aventure épique. Nous débarqu?mes
en grand tapage sur la place de l'endroit, feutres
en bataille et lavallières au vent, au milieu des
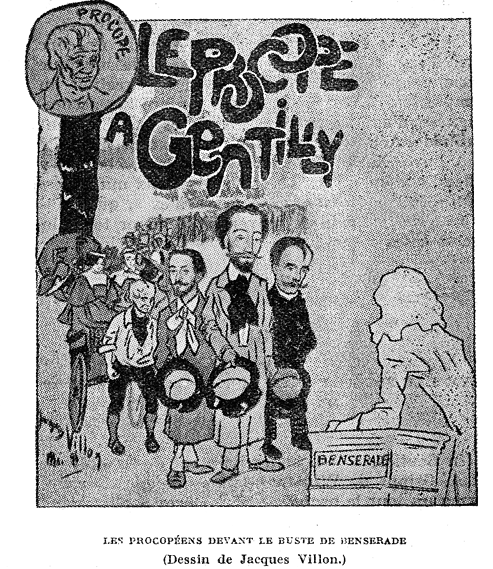
Gentilliens affolés et quelque peu scandalisés par les minois parisiens des jeunes Procopéennes.
Sur les gradins de l'école, une centaine de personnes - le Tout-Gentilly artiste et mondain avaient pris place, quand j'annon?ai que la séance était ouverte et donnai la parole à M. Grippa de Winter qui s'était chargé de rappeler quels titres avait Benserade, poète favori de Louis XIV et académicien, à l'admiration de ses compatriotes. Puis M. Achille Ségard, avocat et homme de lettres, parla du poète de salon et de l'auteur tragique qui voulut - l'imprudent ! - plaire aux lettrés en même temps qu'au vulgaire. Le petit boniment de M. Ségard ne manquait point de malice ; mais personne ne parut s'en apercevoir.
à mon tour je grimpai sur l'estrade et, avec cette belle assurance que vous confère la jeunesse, je dis cet impromptu de circonstance, griffonné la veille, et que j'avais pris le temps d'apprendre par cœur
C'est un impromptu !
Il fut de mode
A la cour, autrefois, de rimer l'impromptu...
De ce jeu, mon esprit assez mal s'accommode.
Je ne vous cèlerai que j'ai toujours vécu
Dans la haine du vers plat... et de l'impromptu.
Un sonnet à Philis serait mieux mon affaire.
Je mettrais, comme l'autre, un quart d'heure à le faire
Et, comme lui, je parlerais très fort,
De soupirs, de langueurs et d'amoureux transports.
Mais plus cruelles, las ! que celles de naguère,
Les belles d'à présent ne m'écouteraient guère,
Et j'en serais pour mes soupirs et mes hélas !...
Le temps n'est plus où les belles marquises
Pour nous mieux enflammer se poudraient à frimas.
Marquises d'aujourd'hui, dessus vos cheveux plats,
Ces neiges ne sont plus qui vous faisaient exquises.
De beaux seigneurs tout d'or couverts
S'en venaient par les bosquets verts,
Au bras de folles amoureuses ;
Et leurs voix se faisant charmeuses,
Parfois, au détour d'un massif,
Entre la nuque et la dentelle,
Ils glissaient un baiser furtif
Qui faisait se p?mer la belle...
Beau temps passé, combien je vous regrette !
Bienheureux temps où l'amourette
Naissait en de galants propos ;
Gentil siècle des grands chapeaux,
Des mollets, du marivaudage,
Où les perruques,
le langage
Et les mollets... tout était faux !
Je vous préfère, quoi qu'on die,
A notre temps, siècle menteur,
Où l'on donnait la comédie,
Où Molière était grand seigneur...
Alors, combien d'amours exquises
S'ébauchaient entre deux baisers !
Mais où sont les belles marquises
Aux cheveux poudrederizés ?...
La seconde partie du programme était consacrée à l'audition des poèmes et des chansonniers du Procope. Ce fut, comme bien l'on pense, le moment le plus gai de la matinée. Chacun crut devoir blaguer ce pauvre Benserade, et j'y allai moi-même de ma petite rosserie.
M'sieu Benserade, écoutez-moi donc !
C'est M'sieu d' Winter qui veut s' payer votre tête !
Camille Girault dit le Sonnet de Job ; un autre celui d'Uranie :
Deux sonnets partagent la cour ;
Deux sonnets partagent la ville...
La fameuse querelle faillit recommencer !
On entendit enfin des romances du XVIIe siècle.
Puis, des airs de ballets, des ariettes et des menuets furent exécutés par un excellent orchestre dirigé par Alcib Mario, pianiste attitré du Procope.
Nous quitt?mes Gentilly au milieu des acclamations, fiers de notre succès et quelque peu étourdis par le petit vin d'honneur que M. le Maire, reconnaissant, avait tenu à nous offrir.

De nombreuses sociétés littéraires se réunissaient à cette époque au Procope. Je cite pour mémoire les Rosatis, société fondée avant la Révolution par Robespierre et Carnot et qui groupe les écrivains des provinces d'Artois, de Flandre et de Picardie ; la Revue d'un Passant, que dirigeait F. de Bucé, et La Cloche de Georges Elcar.
L'école félibréenne fondée par Charles Maurras donna au Procope une soirée à laquelle assista Frédéric Mistral. Les Loups de Belval-Delahaye y "hurlèrent" pendant un certain temps. Bien d'autres groupements tinrent là leurs assises...
Enfin, c'est au Procope qu'eurent lieu, il y a quelques années, les premiers dîners de la Carte Rouge. Et il est amusant de remarquer que nos modernes critiques avaient choisi, pour se réunir, ce même café où jadis on venait prier La Morlière d' "honorer" de son b?illement telle pièce que l'on voulait tomber !

A la veille de l'ouverture de l'Exposition de 1900, Théo forma le dessein d'y reconstituer son vieux café tel qu'il l'imaginait à travers les documents qu'il avait réunis.
J'ai retrouvé la copie du projet soigneusement étudié qu'il se proposait de présenter au Conseil municipal de Paris.
Après avoir résumé en quelques lignes l'histoire du Procope et donné le programme des soirées et des matinées qu'il voulait organiser dans le décor du café fameux, Théo déclarait?:
"Aucune idée de lucre ne préside à ce projet ; seul, un intérêt supérieur, celui de l'art, anime le demandeur, directeur du Café et du Journal Le Procope, qui depuis sept années fait partie de la Société Historique du VI' arrondissement et possède tous les documents anciens propres à assurer une exacte reconstitution."
Hélas ! Ce beau rêve de Théo ne put se réaliser. Ce fut, pour le pauvre homme, un gros chagrin.

Une autre peine lui était réservée dont il ne devait pas se consoler. A donner à boire aux artistes, le "troquet-artiste" ne fit pas fortune. Georges Montorgueil le rappelait naguère dans le Temps : "Le Procope lutta en vain, sept ans, contre la rivalité grandissante de la brasserie."
"Il eut pourtant de beaux jours, ajoutait notre confrère. Il eut figure de centre littéraire avec Ponchon, Paul Arène, Laurent Tailhade, Dubus, Signoret, Millandy, Trimouillat, Xavier Privas, Hyspa. Les apparitions de Fran?ois Coppée, d'Anatole France, d'Oscar Wilde y firent sensation. Puis les miaulements du Chat Noir attirèrent vers Montmartre quelques-uns de ses plus fidèles. Cet exode accentua son déclin. Théo Bellefonds rendit aux muses bienveillantes sa serviette de gargotier."
Ah ! le dernier soir du Procope... Quand deux heures du matin sonnèrent, nous ne p?mes nous résigner à partir... On ferma les portes, on éteignit les lustres ; mais, derrière les volets clos, nous avions allumé des bougies et nous parlions bas, comme on parle dans la chambre d'un mort. Théo pleurait, et nous avions grand'peine à retenir nos larmes. On évoqua des souvenirs. Escourrou, en essayant de sourire, conta des anecdotes. Puis, à l'aube, après l'ultime tournée offerte par le patron, nous serr?mes les mains du brave homme, de sa femme, de la caissière, des gar?ons... et la tête lourde, le cœur serré, nous nous quitt?mes brusquement, pour ne pas nous voir pleurer.

Il y a quelques années, les journaux annoncèrent que la baronne Thénard, devenue propriétaire du Procope quand celui-ci fut vendu à l'encan, en 1872, avait par testament, légué le vieux café à l'Assistance publique, à la condition que rien ne serait changé dans l'aspect extérieur de l'immeuble et que le balcon en fer forgé du premier étage serait respecté. Par malheur, la bienfaitrice, au lieu d'un testament, en laissa dix-neuf, et si contradictoires que les gens de loi eurent toute latitude d'en discuter. L'Assistance publique, déboutée en première instance, accepta de transiger, sans clause restrictive, pour trois millions. La maison lui resta. La démolira-t-on quelque jour, pour élever là un immeuble dans le go?t moderne ?
Présentement, le Procope n'est plus qu'un banal restaurant où déjeunent en h?te des commis et des calicots. La salle du premier étage, d'où s'envolèrent tant de vers ailés, est à présent livrée aux "noces et banquets". On n'y entend plus que les refrains stupides des gar?ons d'honneur, ou les discours indigestes des présidents de Sociétés. Et je ne puis passer dans la rue de l'Ancienne-Comédie sans évoquer avec mélancolie le vieux café culotté et si accueillant où, dans l'?cre et délicieuse fumée des pipes, j'ai chanté, il y a quelque trente ans, mes premières chansons !
XIV.
Caveaux et cabarets du Quartier Latin. - Le caveau du Cercle.
Le Procope fut le premier cabaret montmartrois du Quartier Latin ; mais il y avait dans le même, temps, aux environs du Boul' Miche, bien d'autres boites où les jeunes poètes et les chansonniers en herbe pouvaient s'essayer devant un publie amusé et indulgent.
J'ai parlé, dans un précédent chapitre, du Soleil D'or, le plus célèbre caveau au Quartier. Je me serais contenté de citer les noms des autres sous-sols plus ou moins littéraires de la rive gauche, si le hasard ne m'avait fait découvrir la retraite d'Henri Méryc, qui fut directeur de plusieurs d'entre eux, et vit s'ouvrir et se fermer tous les cénacles et cabarets du Quartier.
Dans le petit café du boulevard Montparnasse, où il a coutume de venir, tous les samedis, bavarder avec quelques vieux amis, je le reconnus tout de suite, encore que l'?ge l'ait un peu courbé et que sa barbiche, jadis du plus beau noir, fut devenue blanche comme neige.
Avec quelle joie le brave homme rappela ses souvenirs et me parla des camarades dont quelques-uns connaissent à présent la célébrité.
"En 1878, me dit-il, Emile Goudeau et Rollinat fondèrent, vous le savez, au Quartier, la Société des Hydropathes, d'où devait sortir le Chat Noir. Mais le premier "cabaret" du Quartier Latin fut ouvert en 1883, par Maxime Lisbonne, rue Soufflot, là même où l'on construisit le bruyant Café de l'Université. Les clients étaient servis chez Lisbonne par de jeunes femmes costumées en pensionnaires de Saint-Lazare et par des gar?ons déguisés en carabins. Devant les plaintes des locataires de l'immeuble (de graves professeurs pour la plupart), que le tapage fait dans l'établissement empêchait de dormir, et que scandalisaient les tableaux trop suggestifs exposés à la porte, congé fut donné à Lisbonne et à ses chansonniers.
Un des chanteurs de l'endroit, Chopinette, élève de Bruant dont il avait adopté le costume et le répertoire, fonda alors, rue Gay-Lussac, à la place où se trouve maintenant la gare du Luxembourg, le
Caveau des Alpes Dauphinoises..."
J'avais oublié Chopinette et les Alpes Dauphinoises ; mais soudain, je me suis rappelé le sous-sol, les tableaux accrochés en un curieux désordre, le piano martyr, les tables encombrées de bocks, et la fumée qui flottait sur tout cela, si épaisse que l'on avait peine, en arrivant, à distinguer les auditeurs et les artistes.
C'est aux Alpes Dauphinoises que j'entendis chanter pour la première fois, les Stances à Manon.
Je revois encore les jeunes étudiants et les rapins fredonnant, la tête penchée sur l'épaule de Mimi ou de Musette, les derniers vers de la jolie chanson de Boukay
J'aime ton cœur inhumain ;
Tu me trahiras demain,
Mais ce soir je t'aurai tout!
Ah ! l'heureuse époque où les amoureux ne s'embarrassaient pas de littérature, et où il n'était point ridicule de paraître ému en écoutant une romance !
"Bientôt, continua Méryc, Chopinette transportait son "cabaret" dans les sous-sols du Paradis Latin, immense music-hall que l'on venait de construire rue du Cardinal-Lemoine, et qui ne devait avoir qu'une vogue éphémère.
"Peu après s'ouvrait, rue de Rennes, le Café de Clémence-Isaure dont je pris la direction. Ce fut longtemps le café littéraire le plus intéressant de la rive gauche. Les chansonniers et poètes de La Plume y fréquentaient assid?ment. Casemajor, maître de chapelle de Saint-Louis-en-l'Isle, tenait le piano.
"En 1892, fut fondé le Soleil-d'Or, place Saint-Michel. La direction m'en fut offerte, et j'acceptai d'aller présider aux destinées du caveau fameux."
Et Méryc me rappela, non sans mélancolie, les noms des cabarets nombreux qui à cette époque égayaient la rive gauche le Quartier Latin, rue Saint-Jacques ; le Café des Arts, rue Le-Goffic ; le Café des Pierrots, avenue Victoria ; le premier Cabaret du Grillon, rue Cujas, où Victor Tourtal faillit être assommé pour avoir, dans certaine chanson, malmené Gyp assez lourdement ; les Escholiers, rue Champollion et, dans la même rue, le Cabaret de la Bohème, que dirigea pendant un certain temps un joyeux gar?on du nom de Gadbin qui, voulant à son tour connaître la gloire, se fit acrobate, présenta aux Folies-Bergère, le curieux numéro de l' "Écrasé vivant" et se tua dans un cirque, à Berlin, en exécutant un autre exercice plus périlleux : "Le Saut de la Mort" ! La Taverne du Pont-Neuf, rue de Rivoli ; le Cabaret de la Bohème, rue Saint-Jacques ; le Cabaret du Rire, simple beuglant, où six femmes sur la scène faisaient la "corbeille", et enfin le Caveau du Cercle, boulevard Saint-Germain, dont Léo Lelièvre, aujourd'hui revuiste réputé, était à la fois le directeur et la vedette.
Longtemps encore Méryc me parla du Vieux Quartier où il connut tant de littérateurs et d'artistes arrivés. Et puis, la voix du brave homme se fit triste soudain. Il me confia?:
"Un dur labeur m'oblige maintenant à vivre loin de ce quartier que j'ai tant aimé. De temps en temps je monte à Montparnasse, où je retrouve quelques vieux amis et quelques vieux souvenirs. C'est là ma seule récompense ! Les Muses sont ingrates !"
Henry Méryc est mort il y a peu de temps loin de Paris, oublié de tous. Les hommes sont ingrats !

Les caveaux et les cabarets du Quartier eurent des fortunes diverses, et la plupart passèrent entre les mains de nombreux tenanciers qui n'étaient pas plus commer?ants qu'artistes. Cependant le Caveau du Cercle installé dans le sous-sol d'un bourgeois café boulevard Saint-Germain, connut durant plusieurs années une vogue extraordinaire, gr?ce à l'entrain et à l'habileté de son directeur artistique le chansonnier Léo Lelièvre, un ancien artiste capillaire que ses camarades facétieux avaient surnommé le merlan chanteur.
Le Caveau du Cercle était un singulier milieu.
Dans la salle étroite, au plafond bas où l'air était bientôt irrespirable, s'entassaient chaque soir, autour des rapins et des poètes chevelus, tous les petits boutiquiers du Quartier auxquels se mêlaient sans paraître autrement gênées, des filles du carrefour Buci et des marloupiots en casquette, venus là s'attendrir aux roucoulades de la romancière ou se donner du cœur en écoutant chanter les exploits du Julot de la Maubert ou de la Rouquine de Montparno. Déjà, en ces temps lointains, fleurissait la chanson apache. Mistinguett n'a rien inventé !
Imposer silence à ce public houleux et panaché n'était pas chose aisée.
- T?chez de la boucler, là-bas, dans l'aquarium ! criait Lelièvre. Quand vous voudrez faire cesser le bruit de vos nageoires, nous entendrons notre camarade le poète Machin dans ses œuvres. C'est de la poésie, ?a, bon Dieu !
Et le camarade surgissant derrière le piano, y allait de sa petite salade, accompagné par le compositeur Jules Legay, le plus fidèle collaborateur de Léo.
J'ai entendu là d'étranges poètes et de bien bizarres artistes qui tous ne manquaient pas de talent Alfred Dalibard, l'auteur de l'Absinthe et de la Soupe à deux sous ; Marc Leclerc, qui s'appelait alors Marc-Aurèle et qui devait rapporter de la guerre ce beau livre : La Passion de notre frère le Poilu ; Charles de Rochefort, devenu vedette de cinéma, après avoir été acrobate de tapis, et que nous connaissions sous le nom de Jean Misère ; le chansonnier rabelaisien Paul Paillette ; le monologuiste Coulet ; les poètes Guy Perron, Yvanof, P.-E. Demouth, de Reuze, du Coudray, Caligula, Pierre Chapelle, Jehan des Islettes ; le compositeur Paul Fauchey et le jeune organiste Louis Dodement avec qui j'ai, plus tard, écrit un Noël religieux qui fut plusieurs fois exécuté en l'église Saint-Louis-en-l'Isle.
J'ai entendu, au Cercle, les imitations musicales de Tony's que j'ai retrouvé au music-hall, et j'y ai applaudi d'amusants couplets chantés avec bonne humer, parfois avec intelligence, par Gavrochinette et par la blonde petite Paulette qui susurrait si ingénument?:
Je suis masseuse,
Je suis masseuse,
Je fais maigrir les gros messieurs...

Le chansonnier le plus écouté et le plus aimé était
sans contredit le maitre de céans Léo Lelièvre, speaker, humoriste et poète.
.
Tous ceux - et ils sont légion qui sont descendus dans le sous-sol fameux du boulevard Saint-
Germain se rappellent avoir entendu Lelièvre chanter de cette voix acide qui dominait le plus assourdissant vacarme, ces chansons qui, sans doute,
n'étaient pas des œuvres d'une extr?me finesse, mais
qu'il disait avec un entrain irresistible : Vadrouille
d'etudiants, Souvenirs de dèche, Le Sommeil de Môminette, et cette chanson sentimentale - car Léo faisait aussi la romance - La rue où ne passe
personne.
J'ai dit que la clientèle etalt un peu m?lée. Pourtant, bien des gens aujourd'hui célèbres et dont quelques-uns déja étaient connus du grand public, passèrent au Caveau du Cercle. On y vit Ed. Herriot,
Malvy, Emile Bure, Chauchat, La Fouchardière,
Trotsky, Rappoport, Thivrier, le député en blouse,
et Anatole France, qui honorait Léo Lelièvre de
son amitié.
Je n'ai pas oublié que ce brave Léo me donna,
jadis, quelques sages avis et m'invita a mieux défendre mes intér?ts d'auteur. Je n'ai guère profité
du conseil. Je lui garde pourtant, une amicale reconnaissance.
Lelièvre, qui en ce temps-là était chevelu comme
Absalon, est aujourd'hui aussi chauve que Jules
Moy. Qui donc disait que le travail cérébral activait
la pousse des cheveux? Lelièvre a beaucoup travaillé; je veux dire qu'il a beaucoup produit. II est
devenu l'indispensable collaborateur de M. Henri
Varna et il a signé avec celui-ci nombre de revues
généreusement déshabillées.
C'est sans doute à son acharnement a rimer des
couplets sur taut d'airs connus on inédits qu'il doit
d'etre president de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ce n'est pas son
meilleur titre à notre admiration et a notre sympathie. On oubliera le revuiste et l'administrateur,
mais on se souviendra de ce chansonnier pittoresque qui, dans le sous-sol du boulevard Saint-Germain, amusa et attendrit toute une génération d'étudiants, de grisettes, de marlou et de petits bourgeois.
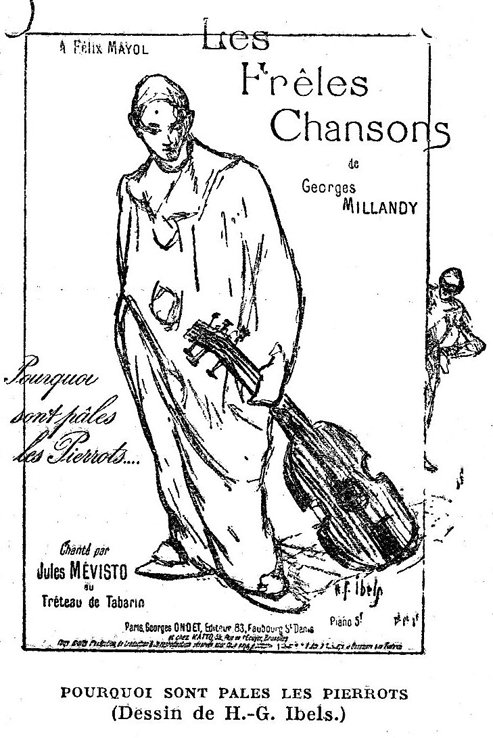

  
|




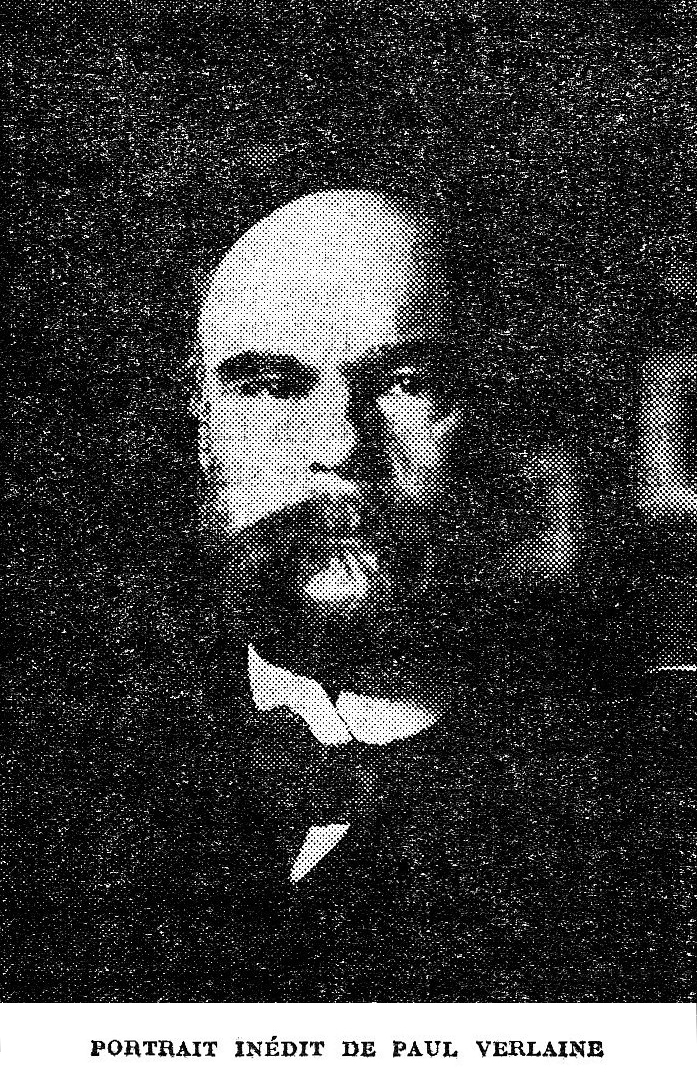










 <
<